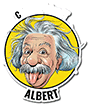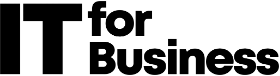Gouvernance
« La smart city se réinvente sans cesse grâce aux avancées du numérique »
Par François Jeanne, publié le 09 juin 2023
Réalité virtuelle, intelligence artificielle, open data, chiffrement homomorphe, GAN… Autant de briques technologiques exploitées par Patrick Duverger pour construire le cœur numérique de sa ville, en puisant les expertises et les idées neuves à deux pas d’Antibes, dans la Technopole de Sophia Antipolis, et avec le réalisme qu’impose son rôle de directeur des moyens généraux.
Entretien avec Patrick Duverger, Directeur des systèmes d’information et des moyens généraux de la Ville d’Antibes
Cela fait plus de quinze ans que vous êtes à la DSI de la Ville d’Antibes. Ce sont les perspectives de la smart city qui vont ont attiré et retenu ?
J’ai d’abord travaillé pour plusieurs entreprises sur la Technopole de Sophia Antipolis. C’était très intéressant, mais dans mon nouveau rôle à la direction des systèmes d’information, des moyens généraux et d’une partie des services techniques, je touche du doigt la complexité de la gestion des personnes et des procédures, et de l’administration. Cela fait 16 ans exactement et je ne m’en lasse pas. Mais la smart city, à mon arrivée, n’en était qu’à ses débuts.
La DSI de la ville compte 25 personnes, sur les 110 de ma direction. Il faut dire que dans les moyens généraux, il y a la gestion des véhicules, celle des achats ou encore de la supply chain, et la gestion des réseaux, d’eau, de gaz et d’électricité. C’est intéressant car nous pouvons directement mettre en œuvre l’innovation numérique dans ces services techniques. La preuve, lorsque nous avons renégocié la délégation de service public de l’eau potable, nous avons développé une vision très analytique des 415 km du réseau et de sa vétusté grâce à notre SIG et aux outils de BI. Cela nous a permis d’obtenir le plus bas prix de l’eau en France.
Combien d’applications devez-vous gérer aujourd’hui ?
Nous avons une cinquantaine d’ERP, c’est-à-dire de logiciels avec une base de données centrale qui servent un métier en particulier dans la ville. À l’éducation, la culture, la voirie, l’urbanisme, etc., chacun dispose de son ERP, voire de plusieurs, avec des données métiers qui ont besoin de persistance. Bien entendu, faire le lien entre ces éléments est particulièrement complexe. Mais il le faut, ne serait-ce que pour gagner du temps en évitant des ressaisies multiples. Et surtout, cela renforce notre contrôle sur la gestion de la ville. Nous avons fait le choix d’un data lake pour y parvenir.
Avez-vous entamé un mouvement vers le cloud qui pourrait amener de la simplification ?
Non. Nous sommes presque totalement on-premise, sauf pour quelques applications qui ne sont proposées qu’en mode SaaS. C’est assumé, car avec le code des marchés publics, l’attribution d’un contrat à un éventuel fournisseur de cloud peut être remis en question quatre ans plus tard lors d’un renouvellement. Et si les liens avec ce cloud sont très intégrés, comment fait-on pour changer ? Cela représente beaucoup de travail, notamment des reprises de données complexes. Nous avons donc notre propre datacenter, dans un bâtiment de la ville, qui est redondé avec un autre sur la Technopole pour notre PRA.
Venons-en à votre budget et notamment à la part que vous en consacrez au développement de la smart city.
Nous disposons d’à peu près 2 M€ pour le fonctionnement, et de 1 M€ pour l’investissement. Dans cette partie, la moitié environ est dédiée à la smart city. Ce sont des budgets relativement modestes pour une ville de 80 000 habitants, qui monte à 250 000 l’été. Mais l’avantage du numérique, c’est qu’avec un zéro de moins par rapport à un projet de voirie ou de BTP, vous avez déjà de beaux résultats. Et donc, en fait, il n’y a pas vraiment de limite à notre budget. Nous pouvons argumenter plus facilement pour obtenir une ligne de 100 k€ que ceux qui font un rond-point à plusieurs millions d’euros. Tout dépend surtout de la volonté politique. Et celle du maire, Jean Leonetti, ne fait pas défaut, notamment pour proposer de nouveaux services aux citoyens.
L’informatique a parfois été vue par le passé comme un faire-valoir par les élus. Avons-nous dépassé ce moment ?
Tout le monde a compris que le numérique est indispensable. Et ce n’est pas grâce à la DSI, c’est juste un état de fait. Dans toutes les directions métiers, ou lorsqu’on doit fournir des services aux citoyens, étant donné que ceux-ci sont demandeurs de cette dimension, le volet numérique est déjà naturellement inclus.

« Les start-up ont besoin de cas d’usage pour montrer la valeur de ce qu’elles délivrent. Or à la ville, avec tous nos métiers, nous avons presque toujours celui qui va les intéresser.«
Lorsqu’en revanche le numérique est un faire-valoir, un élément d’image, nous avons décidé à Antibes d’agir à titre non onéreux. Nous l’avons fait à quatorze reprises jusqu’ici. Ce choix nous libère du code de marché public qui ne nous autorise pas à choisir de travailler avec une entreprise plutôt qu’une autre. Par contre, si on ne dépense rien, il n’y a pas de commerce. C’est donc seulement une convention de partenariat qui est signée, résiliable de plein droit par chacune des parties. Nous en avons passé plusieurs avec des start-up ou des grands groupes. La Technopole voisine est évidemment un réservoir d’opportunités. Là, oui, nous communiquons sur ces innovations, parce que nous sommes souvent les premiers à proposer des réalisations.
Avec quel type de sociétés travaillez-vous le plus ?
Nous sommes ouverts à toutes. Les start-up ont besoin de cas d’usage pour montrer la valeur de ce qu’elles délivrent. Or à la ville, avec tous nos métiers, nous avons presque toujours celui qui va les intéresser et leur permettre de tester leur solution en passant à l’échelle.
Mais nous avons aussi été en partenariat avec SAP, au moment de l’apparition du nouveau protocole Bluetooth au début de l’IoT. Ils voulaient en comprendre la valeur ajoutée et nous avons installé des balises dans des monuments d’Antibes, ce qui a permis de proposer aux passants qui s’en approchaient des messages explicatifs sur leur téléphone. Depuis, nous avons des liens privilégiés avec le laboratoire de recherche SAP Security Research à Sophia Antipolis.
Comment vos collaborateurs vivent-ils ces projets ? Cela doit être très entraînant ?
Absolument. Les agents de la DSI savent très bien faire le tout-venant, l’opérationnel. Mais le brassage culturel avec les chercheurs et les ingénieurs venus de partout que l’on trouve à la Technopole, c’est évidemment très enthousiasmant. Pour la motivation des équipes, c’est donc très bien. Pour l’image de la ville, aussi. Et enfin, c’est à l’honneur du secteur public en général, qui a un devoir de travailler avec des start-up qui essaient de créer un métier et un business.
Vous avez tout de même la chance d’avoir un bel écosystème autour de la smart city dans votre région, n’est-ce pas ?
C’est vrai. Il y a d’abord une concurrence positive entre les territoires. Il y a aussi le département qui s’organise avec le SMART Deal 06 pour fédérer les différents experts du territoire, que ce soit dans le privé ou dans le public. La Technopole, exemplaire sur ces sujets depuis trente ans, joue également un rôle majeur : les communes travaillant avec Sophia Antipolis sont portées à innover, et à innover au service du public.
Il y a tout de même de la place pour que d’autres métropoles se lancent sur le sujet en France. En fait, la smart city a un intérêt, c’est qu’elle est mal définie. En parler, c’est tout de suite penser à plein de projets, sans qu’il y ait une seule vision du résultat. Elle se réinvente sans cesse. C’est pour cela qu’elle est « smart », entre parenthèses. Si on connaissait très précisément ses contours, on l’achèterait sur étagère en passant un marché public.

« Les communes travaillant avec Sophia Antipolis sont portées à innover, et à innover au service du public. »
Notre vision à Antibes, c’est la réunion de trois sphères : celle de l’IoT, l’internet des objets qui communiquent ; celle des réseaux sociaux, des personnes qui échangent entre elles ; et enfin la sphère des services au public… qui doivent mieux communiquer entre eux.
Lorsque ces trois sphères s’interconnectent, des cas d’usage nombreux et intéressants émergent, qui construisent la smart city. Par exemple, si nous connectons l’IoT avec les réseaux sociaux – c’est-à-dire la population –, nous aboutissons aux compteurs communicants ; les réseaux sociaux avec les services publics, c’est la dématérialisation des procédures et les systèmes collaboratifs ; enfin, les services publics avec l’IoT, ce sont les réseaux intelligents.
Il y a énormément de technologies candidates à cette révolution. Lesquelles mettez-vous en avant aujourd’hui ?
Nous assumons une approche technophile, en partant du principe que c’est en essayant qu’on comprend. Prenons l’exemple de la blockchain, en l’occurrence de la blockchain green, puisque nous n’avons pas besoin de minage pour un usage non ouvert sur l’extérieur. Nous nous sommes focalisés sur les bénéfices potentiels des smart contracts. Et comme dans l’Administration, nous sommes de grands générateurs de processus qui ont fait leurs preuves, à partir du moment où nous sommes capables de bien les comprendre, vient naturellement l’idée de « blockchainiser » ces processus pour les optimiser.
Nous avons appliqué cette démarche dans mon département achats, qui voit passer environ 3 000 mouvements par an, avec des catalogues de références chez les fournisseurs qui comptent parfois jusqu’à 80 000 lignes. L’enchaînement ordre d’achat/réception/livraison de l’utilisateur comporte une dizaine d’étapes et implique entre 10 et 15 personnes, sans compter les éventuels absents à remplacer. La blockchainisation en a rendu visibles les points de blocage, ceux qui le ralentissent et entraînent des pénalités de retard à payer aux fournisseurs ou, à l’inverse, des retards dans la livraison aux métiers. Et nous avons amélioré ces KPI, sans pour autant toucher au processus.
Vous explorez également les technologies d’intelligence artificielle ?
Oui, notamment sur la question de la surveillance vidéo. Nous sommes partis de l’idée que ces caméras coûteuses pouvaient devenir des capteurs d’informations importantes à coût marginal. En faisant des tests dans une enceinte privée, pour rester conformes aux lois de protection de la vie privée, nous avons pu transformer le signal vidéo en une donnée statistique grâce à un réseau neuronal entraîné à compter les véhicules ou à lancer une alerte sur la détection d’un stationnement anormal d’un camion aux abords d’une école par exemple. Et pour garantir l’impossibilité d’une fuite de données, et dans le cadre plus large de la question de la privacy des algorithmes d’intelligence artificielle, l’entraînement des réseaux neuronaux s’est fait sur des données cryptées. Ainsi, personne ne peut associer les KPI renvoyés par l’IA à une image d’origine.
Aujourd’hui, ce n’est qu’un POC. Mais quand on sait que nos 170 caméras aboutissent à un mur de 20 écrans regardés par deux paires d’yeux, on voit bien qu’une vidéosurveillance efficace deviendra tôt ou tard un système assisté où le mur d’images est activé en fonction de traitements d’IA qui détecteront en temps réel les comportements suspects.
Il y a de belles perspectives avec la 3D et peut-être le métavers ?
Tout à fait, nous avons notre jumeau numérique à Antibes ! L’intérêt, c’est de mettre le citoyen au centre de la ville en lui laissant l’accès à ce jumeau, sur le web ou depuis son smartphone par exemple. Ainsi, quand un nouveau projet d’urbanisme sera lancé dans son quartier, il pourra voir à quoi va ressembler cette réalisation, ou quelle vue il aura depuis son balcon… ce qui est une question importante ici ! Eh bien là, il suffit de se placer sur son balcon dans le jumeau numérique pour savoir.

« Avec l’explosion annoncée du métavers, c’est très bien d’avoir déjà notre ville modélisée en 3D. »
Le but c’est de démontrer l’attention que l’on a porté à la question. Bien sûr, la mairie utilise le jumeau numérique pour prendre les bonnes décisions. C’est aussi très utile pour surveiller les réseaux enfouis, avec un casque Oculus sur la tête de l’agent et en liaison avec le SIG et les données fournies par les opérateurs. Et puis, avec l’explosion annoncée du métavers, c’est très bien d’avoir déjà notre ville modélisée en 3D : nous allons être capables de fournir de nombreuses données dans ces univers : l’horaire du prochain bus, en temps réel, mais aussi des circuits piétons pour les touristes, etc.
Un dernier projet étonnant concerne votre utilisation des GAN (réseaux adaptatifs antagonistes, NDLR) au profit de l’open data ?
Cela fait quatre ans que nous testons ces GAN dont on parle tant depuis quelques mois avec ChatGPT. Il faut dire que l’idée de créer une image « réaliste » mais entièrement imaginée grâce à la collaboration de deux réseaux neuronaux est fascinante ! Nous nous sommes demandé à quoi elle pourrait servir. Et l’open data nous a semblé un bon terrain d’expérimentation.
Comme vous le savez, la ville est une mine de données, mais il faut faire attention car certaines data sont sensibles au niveau de la vie privée. Nombre de datasets sont ainsi impossibles à rendre disponibles en open data. Nous avons donc eu l’idée d’utiliser des GAN pour imiter des données réelles en leur faisant créer des sets fictifs sur la base de caractéristiques que nous leur fournissons. Il n’y a ainsi aucun moyen de revenir à une donnée réelle. Du coup les GAN pourraient bien représenter l’avenir de l’open data.
Dans une smart city comme dans la ville réelle, il faut de la sécurité : comment vivez-vous l’accroissement des cybermenaces ?
Nous faisons l’objet d’attaques permanentes. Mais pourquoi attaque-t-on une ville ? Parce que son SI peut être un point d’entrée pour rebondir ailleurs. Les données de notre collectivité n’intéressent pas tant que cela les pirates. Les autres organismes d’État, oui. Nous ne sommes pas l’objectif final du hacker, mais une passerelle.
Cela étant, avec un système d’information très peu exposé via le cloud, nous sommes en contrôle, puisque nous gérons les interfaces avec l’extérieur très proprement, quitte à les interrompre si besoin. Après, il y a un paradoxe. La sécurité la plus élevée dépend toujours du maillon le plus faible, à savoir l’humain. Et lui, vous aurez beau l’éduquer, il fera toujours des erreurs. Pourtant, cela ne sert à rien de le clouer au pilori, car les systèmes d’information que vous concevez, ils sont centrés sur l’humain, à son service.
Voilà pourquoi il faut toujours se renforcer sur ce sujet, avec l’idée de créer un système immunitaire numérique en réponse à ces attaques, grâce notamment à l’IA et à d’autres technologies complexes qui permettent de détecter ou de prévoir une attaque. Nous expérimentons ainsi des dispositifs de chiffrement basés sur des algorithmes homomorphiques afin de pouvoir remonter des KPI sur des données cryptées. Cela garantit la privacy des données et laisse le champ libre pour des remontées d’information d’ordre statistique.
Tout cela augmente forcément la consommation énergétique du numérique. La smart city pourra-t-elle être sobre ?
Le sujet de la sobriété numérique me concerne évidemment, notamment parce que les consommations énergétiques de la ville sont gérées dans ma direction. Nous connaissons donc très bien les chiffres du numérique par rapport au total. Nous avons lancé ce chantier puisque la réglementation a évolué pour les communes de notre taille. Non sans relever un autre paradoxe : d’un côté, nous entendons que la France a raté le virage du numérique et qu’il faut accélérer sur le sujet ; de l’autre, on nous demande d’appuyer sur le frein, parce que le numérique consomme et génère une empreinte carbone.

« Les équilibres sont à trouver de manière holistique. Le numérique doit s’inscrire dans cet objectif : il sert à créer une ville intelligente dont le métabolisme sera plus sain. »
Nous avons donc pris la décision avec David Simplot, l’élu chargé du numérique qui se trouve avoir été le directeur du centre de recherche de l’Inria sur la Technopole, d’assumer une dose de non-sobriété numérique… là où le numérique fait gagner de l’empreinte carbone sur le reste : typiquement le développement de la visioconférence ou du télétravail. Par contre, sur d’autres sujets comme l’impression, nous agissons pour limiter l’utilisation des machines. C’est donc de la sobriété numérique sur mesure.
La smart city suggère qu’on regarde la ville comme un organisme, avec ses différents organes et un métabolisme. Dans le corps humain, c’est archi-complexe : ce qui va faire du bien au foie va nuire à la rate. Pour une ville, c’est pareil : les équilibres sont à trouver de manière holistique. Le numérique doit s’inscrire dans cet objectif : il sert à créer une ville intelligente dont le métabolisme sera plus sain, et le plus efficace en consommation de ressources.
Propos recueillis par FRANÇOIS JEANNE – Photos FRANÇOIS CIMA

PARCOURS DE PATRICK DUVERGER
Depuis 2006 :
DSI et directeur des moyens généraux de la Ville d’Antibes
2004-2006 :
Responsable du centre de compétences européen d’innovation SOA chez HP
2002-2004 :
Responsable de développement Openview chez HP
2000-2002 :
Responsable technique du noyau du logiciel de supervision de réseau TeMIP, chez Digital/Compaq
1996-2000 :
Ingénieur R&D puis ingénieur logiciel, chez France Télécom
FORMATION
Ingénieur des Arts et Métiers (1994) et de Supélec (1996) ;
Ingénieur en chef de l’INET (2008)