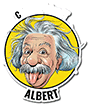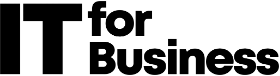Gouvernance
Bull hier, IBM aujourd’hui, et demain les DSI ?
Par Mathieu Flecher, publié le 02 août 2019
Il est toujours tentant de limiter les risques, de céder à la facilité pour s’assurer une pseudo-tranquillité. Toutefois, si nous, DSI, ne nous mettons pas en situation d’innover, nous subirons la même obsolescence que certaines grandes entreprises comme Bull ou Kodak.
Par Mathieu Flecher (*)
Ce qui incite les DSI à travailler avec un partenaire est avant tout la facilité, l’apport fonctionnel, ou l’apport d’innovation et de savoir-faire qu’ils en retirent. Un partenaire qui se Bubullise (verbe du premier groupe « Bubulliser » qui signifie « devenir comme Bull, manquer de vision jusqu’à finir par disparaître ») n’est plus un vrai partenaire. Ses caractéristiques principales : lourdeur administrative, manque d’innovation, bureaucratie autour de l’offre client, trop d’opacité sur les contrats…
Dans la vie courante nous connaissons tous l’exemple malheureux de Kodak, pourtant certains des acteurs actuels du digital ne sont-ils pas en passe de se « Kodakiser » ? En discutant avec un commercial d’IBM, qui me demandait mon avis sur IBM en tant que DSI, je n’ai pu m’empêcher de livrer ma vision sur la situation actuelle de ce grand et historique acteur. Je mettais en exergue le manque de vision et d’innovation – ce qui est certes exagéré quand on garde le nez collé sur la copie, mais qui prend quand même du relief quand on regarde les dernières décennies.
À part Watson, qui est une vraie innovation, rien de transcendant ou d’ultra-disruptif n’est sorti de chez eux. Ils ont aujourd’hui une forte notoriété, et une assise financière qui fait d’eux, selon moi, de « bons gestionnaires », mais pas un acteur majeur de l’innovation pour les années à venir.
Quelle est notre pertinence à nous, DSI, de travailler finalement avec de gros acteurs de cette nature ? L’un des premiers avantages est de nous permettre d’avoir un scope fonctionnel plus large là où, avec de « petits faiseurs », nous sommes sur des niches. Nous gagnons alors en intégration, en urbanisation. S’adresser à IBM dans ce contexte est une bonne chose : besoin de stockage, de puissance serveur, de salle informatique, d’outils intégrés, c’est parfait. La puissance de ces acteurs permet à la majeure partie des entreprises consommatrices d’y trouver leur compte parmi une panoplie pléthorique de services.
La crédibilité vient pour moi en second. Il est toujours plus facile, pour pousser des projets ambitieux, de s’appuyer sur des acteurs majeurs du marché. Pour l’avoir expérimenté, choisir un challenger revêt certains risques. Et quand on dit certains c’est, en fait, beaucoup : entre les OPA potentielles des concurrents, la fragilité économique, la volatilité des salariés et bien d’autres encore, ces challengers sont pour moi à mobiliser uniquement sur des niches.
Mais si nous prenons l’angle de vue inverse, ce qui nous pousserait à utiliser des solutions innovantes, c’est le contre-pied de tout cela. S’adresser à un niche player, à un petit faiseur, représente un avantage indéniable : celui de l’innovation pure et brute, l’innovation claire et limpide, pas une innovation tout de suite tuée dans l’oeuf avec des processus de grosse structure. Comme cela a été le cas, de mémoire, chez Kodak : l’ingénieur qui a développé « l’appareil photo numérique » n’a pas été écouté, entendu ; c’était sans le savoir le début de la fin pour le spécialiste de l’argentique.
J’ai eu plusieurs fois l’occasion de travailler avec de petites sociétés. On leur reproche leur amateurisme, mais leur approche est souvent vivifiante, car elles cassent les codes de fonctionnement. Sur LinkedIn fleurissait il y a quelque temps de cela une maxime attribuée à Henry Ford qui disait à propos des diligences : « si on avait demandé comment améliorer la vitesse des diligences, tout le monde aurait répondu : avec des chevaux qui vont plus vite ». J’aime beaucoup cette maxime, qu’elle soit de lui ou non, car elle met en exergue notre ancrage viscéral à vouloir coûte que coûte rester naturellement dans des modes de fonctionnement qui, peut-être, nous rassurent.
Ici nous avons parlé des fournisseurs, gros ou petits faiseurs, mais qu’en est-il de nous, DSI, en tant que personnes et en tant qu’entités ? Comment restons-nous compétitifs au sein de nos entreprises ? Sommes-nous conscients que notre assise et notre légitimité ne reposent finalement que sur une décision organisationnelle de notre PDG qui légitimise nos actions en matière d’IT ? Les utilisateurs ne nous comparent-ils pas à IBM et à ses lourdeurs administratives ? Ne sommes-nous pas nous aussi aveugles de la situation, de notre situation qui nous empêche de réaliser que finalement nous ne rendons peut-être pas le service le plus disruptif ni le plus efficace, et peut-être encore moins le plus rapide…
L’histoire du Bull d’hier et d’IBM d’aujourd’hui doit nous forcer à, nous aussi, nous structurer avec des organisations SI réellement disruptives, sous peine de quoi les utilisateurs auront une certaine forme de résignation à nous utiliser et, un jour ou l’autre, nous aurons la surprise, si nous ne nous remettons pas en cause, de subir le même sort que Bull. Les cellules innovation, encore trop rares au sein des DSI, doivent émerger. Et il faut accepter, comme pour la théorie de l’évolution des espèces, de devoir disparaître pour mieux revenir, cette fois adapté à un environnement changeant, toujours plus numérique et correspondant aux vrais besoins de nos clients internes.
(*) Mathieu Flecher est le pseudonyme d’un DSI bien réél