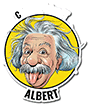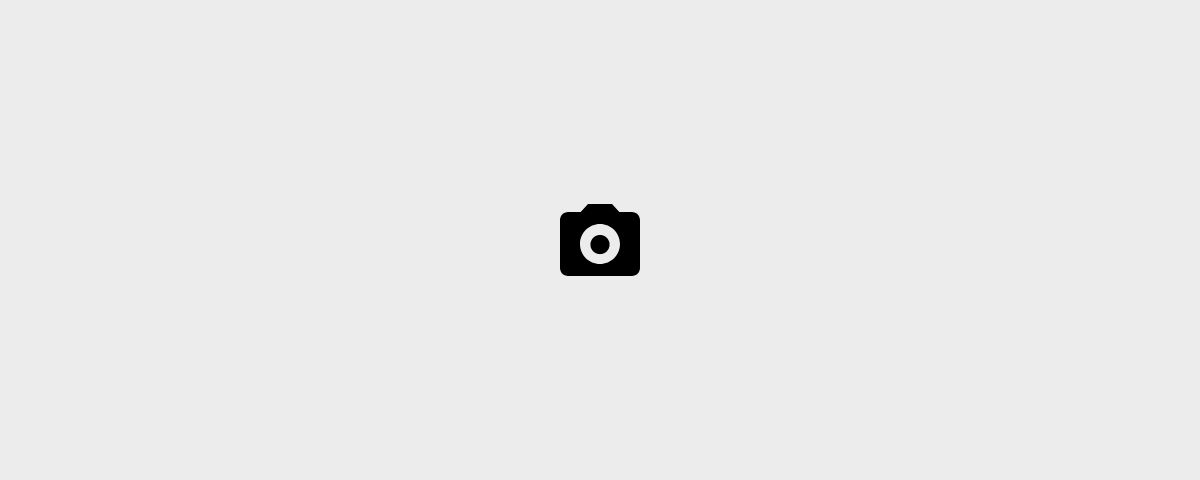
DOSSIERS
«L’informatique, instrument de pouvoir»
Par La rédaction, publié le 05 septembre 2011
Albert Ogien, directeur de recherches au CNRS et enseignant à l’EHESS, a étudié le rôle de l’informatique dans les administrations d’Etat et comment les systèmes d’information changent la façon de gouverner.

Comment un sociologue en vient-il à s’intéresser à l’informatique ?
Albert Ogien : J’ai découvert l’importance de ce domaine il y a une vingtaine d’années, dans le cadre d’une enquête sur la manière d’attribuer les prestations sociales comme l’APL (Aide personnalisée au logement). En étudiant le travail des services de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf) pour ouvrir et modifier le droit à la prestation, j’ai observé le rôle déterminant du dispositif informatique en cours d’installation dans cet organisme.
Qu’avez-vous découvert exactement ?
AO : Que les gouvernants ont appris à se servir, à des fins politiques, des systèmes d’information mis en place dans les administrations d’Etat. A partir des années 75 et de la mise « sous conditions de ressources » des prestations, on a pu jouer sur leurs critères d’attribution afin de rester dans les limites des enveloppes financières fixées. Et tout ceci sans que les citoyens ne soient collectivement informés de la limitation de leurs droits sociaux. En jouant simplement sur les critères d’attribution, ils s’épargnaient la délibération publique. L’ajustement permanent des paramètres pour contrôler la dépense publique s’est alors imposé comme une technique de gouvernement. Cette technique a été expérimentée dans le cas de l’APL. De légères modifications des critères de surface et de revenus permettent de suspendre les droits de certains allocataires.
Quelle est la place de l’informatique dans ce mécanisme ?
AO : On pense généralement que l’informatique est une technique qui sert à moderniser l’administration, faciliter le travail, réaliser des gains de production ou réduire les effectifs. Selon moi, elle est également un instrument d’exercice du pouvoir. L’informatique permet en premier lieu l’élaboration et la diffusion de données de quantification. Cette dernière consiste à définir des paramètres et des variables de décomposition d’une activité, et à fabriquer des algorithmes de recomposition pour contrôler l’activité en continu et en temps réel.
Toutes les administrations sont-elles concernées ?
AO : Oui. Cette façon de maîtriser la dépense publique a migré de la Caisse d’allocations familiales vers celles d’assurance maladie puis vers l’ensemble des services de l’Etat. En 2006, ce mouvement de quantification gestionnaire a conduit à la Lolf (Loi organique relative aux lois de finances), c’est-à-dire à la présentation d’un budget de la nation composé de missions dont les résultats sont mesurés à l’aune d’objectifs chiffrés et dont la réalisation est appréciée à l’aide d’indicateurs de performance.
Est-ce toujours une volonté de réduction budgétaire qui régit ces pratiques ?
AO : La quantification peut aussi servir à détecter des besoins et à engager plus de dépenses, comme dans le cas de l’Allocation parentale d’éducation ou dans celui de mesures prises en faveur des entreprises. Mais l’introduction de l’informatique dans les administrations a coïncidé avec le projet de limiter l’emprise de l’Etat sur la société et de réduire la dette publique. Du coup, elle sert essentiellement à réaliser des gains de productivité dans l’action publique.
Cela concerne-t-il uniquement la fonction publique et les administrations ?
AO : Non. La quantification gestionnaire touche toutes les activités professionnelles évaluées. Mais l’imposition d’une « logique du résultat et de la performance » à l’action de l’Etat a des conséquences au-delà de la gestion. Le processus de décision politique finit par être guidé par les statistiques émanant des systèmes d’information administratifs : c’est ce que je nomme la « numérisation du politique ».
Est-ce que cela engendre une résistance des personnes sur le terrain ?
AO : La force et la fascination du chiffre sont telles qu’il est très difficile de refuser l’idée selon laquelle une activité doit être soumise à évaluation, même lorsque celle-ci poursuit ostensiblement des objectifs gestionnaires. Il y a, de fait, assez peu d’opposition au principe même de la quantification qui continue à jouir d’une aura d’objectivité, alors même que la définition des critères et des modes de calcul est le monopole d’experts et de techniciens, et échappe au contrôle des agents ou des citoyens. S’il y a peu de résistance aux instructions qui imposent de remplir des tableaux de bord, de renseigner des logiciels, de mesurer les performances individuelles, de conduire des entretiens individuels d’évaluation, on observe cependant que, de façon extrêmement minoritaire, des refus de se soumettre aux obligations liées à cette quantification de l’activité se produisent, que ce soit ouvertement (plutôt dans les services publics) ou de façon clandestine (plutôt dans les entreprises).
Interview parue dans 01 Business & Technologies le 1er septembre 2011.
BIO EXPRESS
60 ans. Doctorat en sociologie à l’université Paris-VII (1984).
Depuis 1991 : directeur de recherches au CNRS et enseignant à l’EHESS, où il dirige le Centre d’études des mouvements sociaux.
De 1995 à 2010 : parution de plusieurs ouvrages. L’Esprit gestionnaire (EHESS) sur les résultats de l’enquête à la Cnaf (Caisse nationale d’allocations familiales) ; Les Règles de la pratique sociologique (PUF) ; Les Formes sociales de la pensée (Armand Colin) ; Pourquoi désobéir en démocratie ?, écrit avec Sandra Laugier (La Découverte).