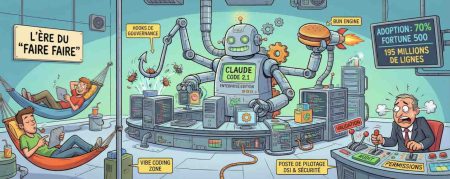Data / IA
Après Nvidia, OpenAI signe un partenariat technologique et stratégique avec AMD
Par Laurent Delattre, publié le 07 octobre 2025
Sam Altman accélère sur tous les fronts : puces, capitaux et contenus. Tandis qu’OpenAI verrouille des milliards de GPU auprès de Nvidia et AMD pour son projet Stargate, son nouveau modèle Sora 2 déclenche une vague de deepfakes et d’interrogations sur la responsabilité numérique.
Sam Altman, cofondateur et CEO d’OpenAI, est décidément un homme très occupé qui semble courir les quatre coins de la planète. On ne parle pas ici des milliers de vidéos de caricatures qui fleurissent sur les réseaux sociaux depuis l’annonce la semaine dernière de SORA 2, le nouveau modèle de génération vidéo très spectaculaire d’OpenAI et de l’app iOS « Sora » qui l’accompagne (cf. encadré).
Non… Ce dont on parle ici, c’est de sa quête aux centaines de milliards de dollars dans le cadre d’une nouvelle levée de fonds et de la concrétisation du pharaonique projet Stargate… Sam Altman mène depuis septembre une tournée mondiale en Asie et au Moyen‑Orient pour sécuriser des financements et des partenariats industriels, rencontrant TSMC, Samsung, SK Hynix ou Foxconn afin de garantir des capacités de production prioritaires pour ses puces d’IA. Parallèlement, SoftBank (grand partenaire financier du projet Stargate) a renforcé sa présence au capital : après avoir mené au printemps une levée de 40 milliards de dollars valorisant OpenAI à 300 milliards, le conglomérat japonais a participé début octobre à une vente secondaire d’actions d’employés, portant la valorisation à 500 milliards de dollars et consacrant la start‑up comme la plus valorisée au monde devant SpaceX.
Après Nvidia… AMD
Surtout, en l’espace de quelques semaines, OpenAI a bouleversé l’équilibre du marché des semi‑conducteurs pour l’IA en orchestrant deux alliances d’une ampleur inédite. Après avoir scellé fin septembre un partenariat stratégique avec Nvidia, assorti d’un investissement pouvant atteindre 100 milliards de dollars et d’un déploiement d’au moins 10 gigawatts de GPU « Vera Rubin » (la nouvelle génération de Superchips après Grace-Blackwell) dans ses futurs centres de données, la société de Sam Altman annonce cette semaine un accord avec le concurrent AMD. Ce dernier prévoit la livraison progressive de 6 gigawatts de GPU Instinct MI450 et générations suivantes, sur les 5 prochaines années. Un premier gigawatt à base de MI450 doit être livré au second semestre 2026. L’accord est assorti d’une collaboration technique approfondie pour optimiser les roadmaps produits d’AMD sur les besoins d’OpenAI ainsi que d’un mécanisme de bons de souscription permettant à OpenAI d’acquérir jusqu’à 10 % du capital du fondeur si des jalons techniques et boursiers sont atteints.
Des partenariats différents mais complémentaires
Sur le fond, le partenariat d’OpenAI avec AMD est similaire à celui signé avec Nvidia : sécuriser la fourniture de GPU de dernière génération sur un marché en tension. Et les deux accords partagent une approche multigénérationnelle, avec optimisation conjointe des feuilles de route matérielles et logicielles.
Sur la forme, en revanche, les deux partenariats sont en réalité d’une échelle différente. Nvidia reste le partenaire historique et privilégié pour l’infrastructure réseau et calcul, mais AMD devient un second pilier, capable de fournir des volumes massifs et de diversifier la chaîne d’approvisionnement. En intégrant AMD dans sa feuille de route, OpenAI gagne en flexibilité pour arbitrer entre cadence d’entraînement et besoins d’inférence, tout en renforçant son pouvoir de négociation face à Nvidia. Pour AMD, l’accord est une validation technologique et une percée commerciale : il crédibilise sa position de challenger sur le segment des accélérateurs IA et ouvre des perspectives de revenus de plusieurs dizaines de milliards sur la durée. En outre, l’accord entre Nvidia et OpenAI promet une montée en puissance de Nvidia dans le capital d’OpenAI. Alors que l’accord AMD/OpenAI promet exactement l’inverse, avec OpenAI susceptible de devenir à terme un actionnaire significatif de son fournisseur. On voit déjà poindre les conflits potentiels avec des intérêts divergents.
OpenAI trace une trajectoire où la puissance de calcul devient l’axe central de sa stratégie, au même titre que la recherche en intelligence artificielle générale (AGI). La simultanéité des partenariats avec Nvidia et AMD, la recherche active de capitaux et la montée en puissance de SoftBank traduisent une ambition : bâtir une infrastructure mondiale capable de soutenir la prochaine génération de modèles, tout en verrouillant les ressources critiques dans un marché sous tension. Dans cette course, chaque gigawatt déployé est autant un atout technique qu’un signal envoyé aux investisseurs : OpenAI ne se contente plus d’être un pionnier de l’IA générative, la jeune pousse veut aussi en devenir le principal architecte industriel.
SORA 2 et son onde de choc Deepfake

Vendredi dernier, OpenAI a déclenché une nouvelle onde de choc dans l’univers de la création numérique avec le lancement de Sora 2, son générateur de vidéos par intelligence artificielle. Présentée comme l’équivalent d’un « moment GPT‑3.5 pour la vidéo » (Sora, première génération étant considérée par OpenAI comme l’équivalent de GPT-1), cette version repousse nettement les limites de son prédécesseur : meilleure maîtrise des lois physiques, cohérence accrue des séquences, visages plus réalistes et transitions fluides. C’est surtout l’ajout de l’audio synchronisé (dialogues, effets sonores, ambiances sonores) qui fait la différence, transformant chaque clip en une production quasi complète.
Parallèlement, la sortie sur iOS d’une App « Sora » animée par le modèle Sora 2 procure aux utilisateurs une interface utilisateur dédiée à la génération vidéo qui favorise les remixes, la collaboration en temps réel, et les partages donnant à l’application des allures de réseau social naissant.
Et, il fallait s’y attendre, SORA 2 a déclenché une vague déjà immense de deepfakes, les verrous mis en place par la startup étant aussi limités en matière de protection des copyrights et de droit à l’image que ceux élaborés lors de la sortie de « GPT-4 Image » au printemps dernier. Plus de 108 000 téléchargements en quarante‑huit heures aux États‑Unis et au Canada, malgré un accès limité sur invitation et réservé à iOS. Dès les premières heures, la plateforme a été envahie de contenus problématiques : deepfakes mettant en scène Sam Altman dans des situations absurdes ou humiliantes (l’intéressé avouant d’ailleurs « ne pas trop savoir quoi en penser »), détournements de personnages protégés par le droit d’auteur – de Pikachu à Lara Croft – et clips exploitant des images de personnes réelles (Michael Jackson notamment) sans contrôle apparent. C’est notamment la très virale fonctionnalité « Cameo » de l’app Sora, qui permet d’insérer un visage et une voix authentiques dans une scène totalement générée par l’IA, qui emballe les premiers utilisateurs et cristallise aujourd’hui les inquiétudes.
Les critiques pointent aussi une politique jugée inversée : aux détenteurs de droits de se « désinscrire » pour éviter l’utilisation de leurs œuvres, au lieu d’obtenir un consentement préalable. Juristes et studios dénoncent un risque de chaos juridique, tandis que les filigranes censés signaler un contenu généré peuvent être aisément supprimés, ouvrant la porte à la désinformation. OpenAI affirme désormais vouloir changer sa politique pour adopter un « Opt-In » exigeant le consentement, mais le mal est déjà fait sur les modèles existants. Reste que la facilité avec laquelle ces contenus circulent interroge et met une nouvelle fois en exergue les impacts sociétaux de l’IA. Non seulement Sora 2 constitue un bond technologique tel qu’il pourrait largement redéfinir la production audiovisuelle et les usages créatifs dans les semaines et mois à venir, mais le modèle – tout comme GPT 3.5 et la sortie de ChatGPT en son temps pas si éloigné – est un nouveau révélateur des failles réglementaires et des tensions entre liberté de création et protection des individus. OpenAI promet un déploiement international rapide, mais la question n’est plus seulement de savoir quand l’application arrivera en Europe : elle est de déterminer dans quel cadre, et avec quelles garanties, cette nouvelle grammaire de l’image pourra s’écrire sans effacer les règles qui la rendent légitime et sans rentrer en conflit avec l’application de l’AI Act.
À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :