
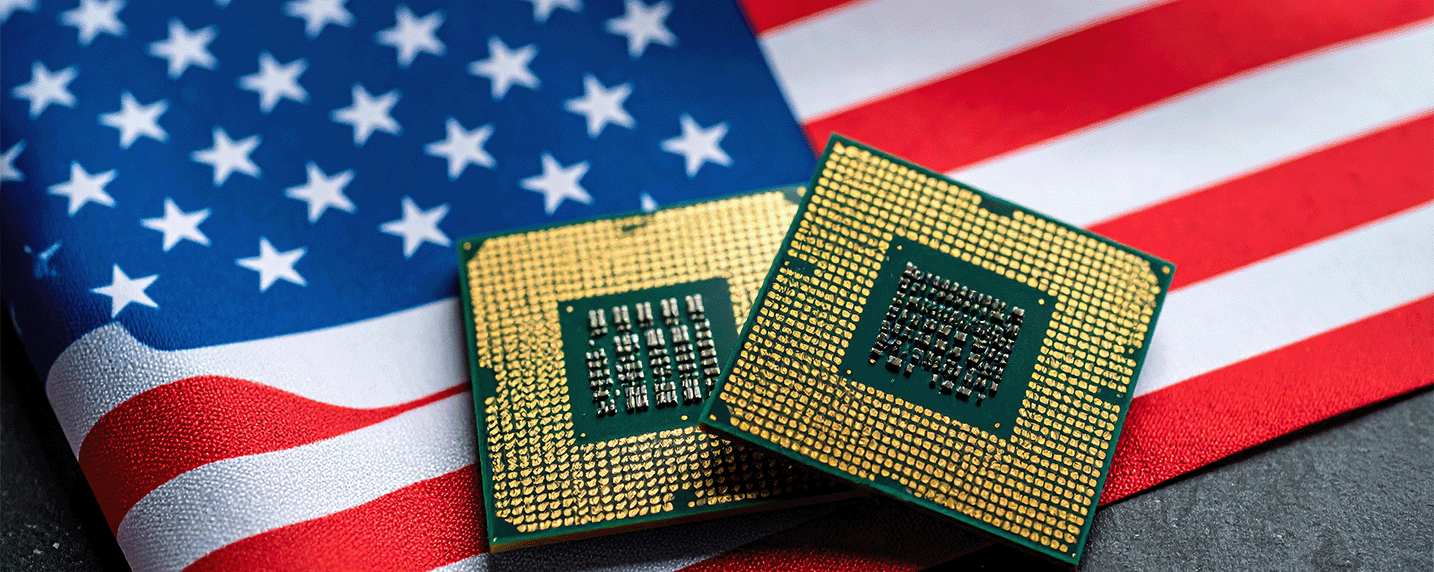
Eco
L’État américain au chevet d’Intel : sauvetage industriel ou pari impossible ?
Par Thierry Derouet, publié le 18 août 2025
Retards industriels, pertes financières, fuite des talents : Intel ne tient plus son rang. La Maison-Blanche s’apprête à s’impliquer directement pour préserver une souveraineté que le marché seul ne garantit plus.
Que l’administration américaine envisage aujourd’hui de s’inviter au capital d’Intel dit tout du chemin parcouru par ce qui fut le joyau de la Silicon Valley. Le champion mondial des microprocesseurs, jadis en position hégémonique, n’est plus que l’ombre de lui-même : six trimestres consécutifs de pertes, 15 % de ses effectifs supprimés, des projets phares abandonnés en Europe, et surtout un retard technologique qui fait tâche dans une industrie où la loi de Moore ne pardonne pas.
L’annonce, rapportée par Bloomberg, a fait bondir l’action Intel de 7 %. Mais elle révèle surtout un constat brutal : le marché ne croit plus à la capacité du groupe à se redresser seul.
Le tournant interventionniste de Trump
Donald Trump, qui menaçait encore Lip-Bu Tan de limogeage il y a quelques jours, a retourné sa veste après une rencontre à la Maison-Blanche. Envisager un tel investissement public consacre une rupture : aux États-Unis, l’État fédéral n’a jamais été conçu comme l’actionnaire de dernier recours de ses champions technologiques.
Mais l’époque change. Trump a déjà exigé une golden share dans US Steel et contraint Nvidia et AMD à partager une partie de leurs revenus en Chine avec le Trésor américain. Avec Intel, il franchit une étape supplémentaire : faire d’un groupe privé un instrument assumé de la politique industrielle et de la souveraineté nationale. Ironie de l’histoire, Donald Trump recourrait ainsi à un programme lancé par son prédécesseur, Joe Biden, pour nationaliser en partie un champion technologique américain.
L’Ohio, symbole d’un échec
Intel avait annoncé en 2022 un projet phare dans l’Ohio : deux méga-usines de semi-conducteurs présentées alors comme le futur plus grand complexe de fabrication de puces au monde. Ce chantier, estimé autour de 20 à 30 milliards de dollars, devait permettre la création de 7 000 emplois durant la construction puis 1 500 postes une fois les fabs en activité. Cependant, le calendrier a dérapé malgré l’aide publique déjà obtenue. Intel a décroché près de 8 milliards de dollars de subventions du CHIPS Act pour son implantation dans l’Ohio et d’autres sites aux États-Unis, mais a dû freiner ses investissements face à la conjoncture.
Le projet accuse désormais au moins cinq ans de retard par rapport aux plans initiaux. La première usine de l’Ohio ne sera achevée qu’en 2030, avec un démarrage de la production prévu entre 2030 et 2031. La seconde usine ne sortirait des wafers qu’en 2032. Intel a annoncé en début d’année qu’il “prenait une approche prudente pour mener à bien le projet de manière financièrement responsable”, ajustant le rythme des travaux à la demande du marché.
Ces mesures drastiques n’ont pas épargné la stratégie d’expansion géographique de l’entreprise. Intel a renoncé à deux grands projets de nouvelles usines en Europe, dont la fameuse megafab de Magdebourg en Allemagne (un investissement de 30 milliards € un temps envisagé avec le soutien de l’UE), ainsi qu’une unité d’assemblage et reporté le lancement de son usine d’assemblage et de test à Wrocław, en Pologne, annoncée en 2023 pour 4,6 milliards € – des projets jugés trop coûteux au vu de la conjoncture. Le nouveau CEO Lip-Bu Tan assume ce repli, estimant qu’Intel doit devenir « une entreprise plus disciplinée financièrement” et concentrer ses ressources sur les sites existants.
La vérité est crue : Intel n’a plus les moyens de ses ambitions. Sans client majeur prêt à s’engager, l’entreprise avance à pas comptés. La Maison-Blanche envisage donc de mettre la main au portefeuille – quitte à socialiser les risques – pour que le projet survive.
Le dilemme stratégique
Au-delà des finances, Intel a perdu son avance technologique, ce qui compromet son rebond à moyen terme. Le groupe autrefois hégémonique s’est fait doubler sur le terrain des procédés de fabrication les plus avancés : TSMC est désormais le maître de la gravure de pointe et produit pour le compte de tiers des puces plus performantes que celles sortant des usines Intel. Par ailleurs, la révolution de l’intelligence artificielle met en lumière le manque de présence d’Intel sur ce segment stratégique. Le marché des puces d’IA est dominé par Nvidia – et dans une moindre mesure AMD – tandis qu’Intel ne propose aucune offre compétitive dans ce domaine en plein essor. Même sur son secteur historique des microprocesseurs pour PC et serveurs, Intel voit sa part de marché grignotée par AMD ces dernières années.
Ces revers conduisent à un questionnement stratégique de fond pour Intel. Historiquement, la force du groupe résidait dans son modèle de fabricant intégré (Integrated Device Manufacturer), maîtrisant tout le cycle de conception et production de ses semi-conducteurs. Mais alors que ses usines accusent du retard, certains observateurs préconisent qu’Intel adopte un modèle fabless (sans usines), à l’image de ses concurrents AMD ou Nvidia qui conçoivent les puces et en confient la fabrication à TSMC.
Pat Gelsinger avait parié sur la relance industrielle tous azimuts. Lip-Bu Tan, plus pragmatique, conditionne désormais tout nouveau projet à la signature d’un “client-héros”. Mais ce réalisme économique heurte frontalement les objectifs de Washington : la souveraineté exige des usines, pas des promesses.
Un pari à très haut risque
Les analystes reconnaissent qu’une entrée de l’État au capital pourrait offrir à Intel un répit décisif, sans pour autant constituer une panacée. L’apport public jouerait le rôle d’“investisseur-héros”, capable de financer le développement des prochaines générations de puces – comme le futur procédé 14A, encore au stade de la recherche – et de donner à l’entreprise l’oxygène nécessaire pour reconstruire un portefeuille clients dans son activité fonderie.
Certains experts y voient un véritable game changer, susceptible de redresser la division production et de remettre sur les rails les chantiers en cours. Jim Cramer, figure bien connue de Wall Street, a même tweeté qu’un soutien fédéral « pourrait achever ce que Gelsinger n’avait pas eu les moyens de mener à terme » en matière d’infrastructures.
En clair, avec l’État à ses côtés, Intel pourrait enfin miser de nouveau sur le long terme, alors que sa trésorerie actuelle ne lui permet plus que des arbitrages défensifs.
Envisager d’entrer au capital d’Intel, c’est admettre que le secteur privé ne suffit plus à garantir la sécurité technologique des États-Unis. C’est aussi courir un risque considérable : injecter des milliards dans une entreprise qui a perdu sa discipline industrielle et son leadership technique.
Les analystes préviennent : un soutien public peut acheter du temps, pas de la compétitivité. Sans percée réelle sur les prochaines générations de puces, le gouvernement américain risque de subventionner le déclin plus que la renaissance.
Intel n’est plus seulement une entreprise en crise : elle est devenue le test grandeur nature de la capacité de Washington à sauver par décret ce que le marché a sanctionné.
À LIRE AUSSI :














