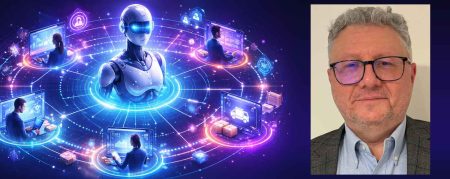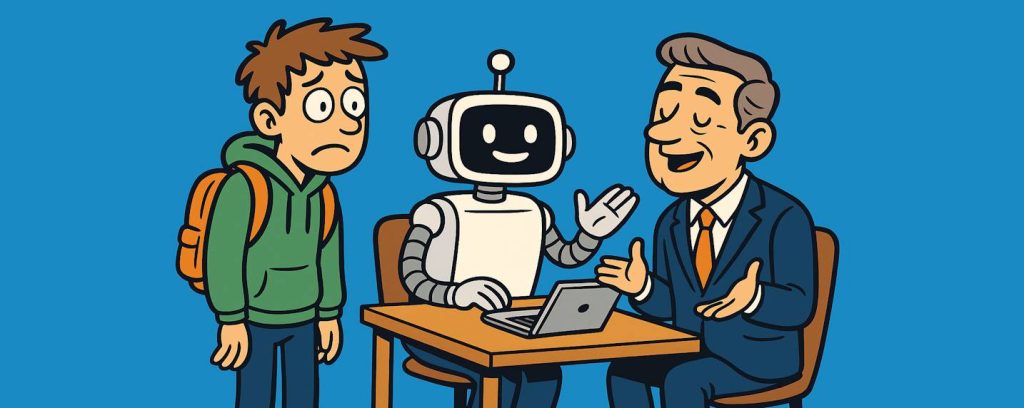
@Work
L’IA redessine le marché du travail au détriment des profils juniors
Par Laurent Delattre, publié le 12 septembre 2025
Quand l’IA s’installe dans les processus métiers, elle valorise les experts capables de l’orienter et fragilise les jeunes qui apprenaient par les tâches d’exécution. Entre accélération des seniors et ralentissement des entrants, un nouveau filtre générationnel apparaît comme le démontre une récente étude de Harvard. Un défi inédit pour la Génération Z.
Maîtriser l’art du “prompt” ne suffit pas : pour faire de l’IA un outil réellement utile, il faut surtout maîtriser son sujet. Plus l’expert métier qui interroge l’IA connaît ses processus, ses données et ses contraintes, plus les réponses sont précises, contextualisées et actionnables. Dit autrement, plus c’est un expert qui interroge l’IA, plus cette dernière sera pertinente et engendrera gain d’efficacité et de productivité.
À l’inverse, sans boussole métier, l’IA accélère plus les erreurs qu’autre chose, voire se montre contre-productive. Cette différence s’explique aussi par la nature des savoirs mobilisés : l’IA remplace plus facilement le « savoir codifié » enseigné en formation que la connaissance tacite accumulée par l’expérience, ce qui protège mieux les profils aguerris que les entrants.
Ce constat est de plus en plus partagé par les directions générales et métiers des entreprises. Elle augmente les professionnels qui savent l’orienter, mais compresse les tâches d’exécution standardisées. Et ce constat commence à impacter déjà les recrutements et le marché de l’emploi. Une étude de Stanford (signée Brynjolfsson, Chandar, Chen) met cette réalité en évidence.
L’IA, nouveau barrage à l’entrée de carrière
Les chercheurs ont étudié des millions de fiches de paie de janvier 2021 à juillet 2025. Et la conclusion principale est assez parlante : depuis la diffusion des IA génératives, l’emploi des 22–25 ans a reculé de 13 % relativement aux autres dans les métiers les plus exposés (développement logiciel, support client, compta), alors que l’emploi global progresse et que les profils plus expérimentés restent stables ou en hausse !
Dans les jobs les plus exposés à l’IA, l’emploi des 22–25 ans baisse de 6 % entre fin 2022 et juillet 2025 quand, sur la même période, il augmente de 6 à 9 % pour les 35–49 ans ; chez les développeurs, l’emploi des 22–25 ans chute de près de 20 % depuis son pic de fin 2022.
Les auteurs montrent que l’impact de l’IA générative sur les jeunes de 22 à 25 ans reste fort, même après avoir pris en compte les différences entre entreprises et périodes. Dans les secteurs les plus touchés, cette tranche d’âge subit une baisse relative de 12 %, un effet jugé significatif. Autrement dit, ce recul ne s’explique pas par des événements propres à certaines entreprises ou à certains secteurs, mais bien par l’arrivée de l’IA elle-même. C’est bien l’arrivée de l’IA qui change la donne.
Ils révèlent également que ces ajustements passent d’abord par l’emploi, plus que par les salaires. Autrement dit, la pression se concentre sur les postes juniors des métiers dits « exposés à l’IA ». Les séries de rémunération montrent peu d’écarts entre âges et niveaux d’exposition, suggérant une certaine rigidité des salaires à court terme : l’effet IA se voit d’abord sur les embauches et les effectifs, pas sur la paie.
Automatiser ou augmenter
L’étude distingue nettement les usages d’automatisation (où l’IA se substitue à des tâches codifiées) des usages d’augmentation (où elle outille les professionnels). Pour l’instant, les baisses d’emploi se concentrent clairement dans le premier cas, quand les rôles où l’IA complète le travail humain se maintiennent, voire progressent, y compris pour les entrants. Mais le phénomène pourrait aussi s’étendre à la seconde catégorie très rapidement avec la démocratisation de l’IA Agentique au sein des outils du quotidien et la généralisation d’assistants IA de plus en plus agentiques très utilisés pour « augmenter » l’humain. Parmi les professions très exposées figurent notamment développeurs, support client, mais aussi comptables/auditeurs ; à l’opposé, aides-soignants et métiers manuels peu exposés ne présentent pas la même dynamique.
Cette bascule est accélérée par l’amélioration fulgurante des capacités des IA : sur le benchmark SWE-Bench, la résolution de problèmes de code est passée d’environ 4,4 % (2023) à 67,6 % (2025), alors même que le benchmark s’est enrichi entre temps. Plus les IA gagnent en capacité d’action et de réflexion, plus – mécaniquement – le périmètre des tâches automatisables s’élargit. En outre, elle est aussi accélérée par l’adoption plus générale de l’IA. On a tendance à perdre de vue que la technologie est encore très récente et que son adoption reste progressive : selon une récente étude SSRN, cette adoption n’est encore que de 46% dans les entreprises américaines.
Dit autrement, l’impact sur l’emploi des jeunes pourrait très rapidement être plus marqué encore.
Une Génération Z sous tension
Sur le terrain, des jeunes actifs utilisent déjà l’IA pour générer du code, aider à déboguer des programmes, résumer des corpus, analyser des jeux de données ou accélérer la documentation, ce qui leur permet de prendre plus vite des responsabilités.
Dans le même temps, la réduction de “petits boulots” d’entrée de gamme menace l’apprentissage par la pratique et le compagnonnage. C’est d’autant plus inquiétant que, en France par exemple, les récentes décisions politiques ont mis un frein à l’apprentissage en alternance, ce qui va clairement à sens contraire de ce que l’IA va imposer sur l’emploi des jeunes.
L’étude confirme que ces tendances ne sont pas propres à la Tech ou au télétravail : les résultats tiennent même après exclusion des métiers informatiques, et restent clairement visibles dans des professions non télétravaillables (y compris guichetiers bancaires, agents de voyage, préparateurs fiscaux) et se retrouvent dans différentes constructions d’échantillon.
En perspective macro, il n’y a pas “d’apocalypse de l’emploi” actée à ce stade : l’effet est hétérogène selon métiers et usages, et l’impact reste graduel. Les auteurs restent prudents sur la causalité et soulignent que les tendances ne deviennent vraiment visibles qu’à partir de fin 2022, dans le sillage de la diffusion des LLM ; ils insistent sur le suivi dans le temps et sur la nécessité de meilleures données d’adoption au niveau des entreprises.
À court terme, l’étude doit être perçue comme une invitation à orienter l’IA vers l’augmentation (gains sur la qualité et la vélocité, pas seulement sur les coûts), à préserver des parcours d’apprentissage supervisés pour les juniors, et à capitaliser sur l’expertise métier — condition sine qua non pour obtenir des réponses fiables et utiles des modèles. Concrètement, cela suppose, notamment pour les DSI et les directions métiers (soutenues par la DSI et les RH), de cartographier les tâches en « automatisables » versus « augmentables », de réserver des « terrains d’apprentissage » où l’IA assiste mais ne remplace pas, et de mesurer l’impact sur les flux d’entrée/sortie d’équipes pour éviter l’érosion du vivier de compétences. Mais une chose est sûre, il est désormais urgent de s’attaquer à ces problématiques et aux défis de l’impact de l’IA sur l’emploi des jeunes… et des moins jeunes.
À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :
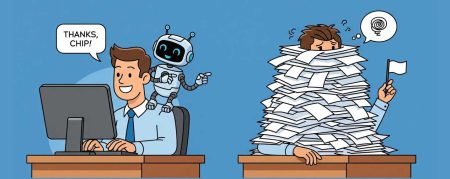
À LIRE AUSSI :