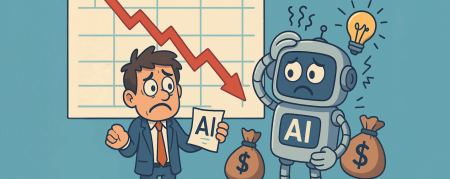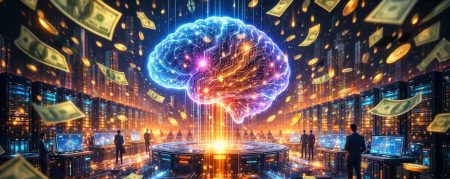Gouvernance
EUDR : la loi qui voulait sauver les forêts trébuche sur ses serveurs
Par Thierry Derouet, publié le 02 octobre 2025
On avait déjà vu la Commission européenne brandir la « simplification » pour assouplir le RGPD et écorner la CSRD dans le paquet Omnibus. Cette fois, c’est un autre registre : pour repousser l’application du règlement contre la déforestation importée (EUDR), Bruxelles invoque un motif inattendu — l’informatique ne suivrait pas.
«Il n’est pas possible de garantir que le système informatique puisse gérer la charge attendue. » L’aveu ne vient pas d’un DSI sous pression, mais de la Commission européenne elle-même. Dans une lettre signée par la commissaire à l’Environnement Jessika Roswall et adressée aux colégislateurs — Parlement européen et Conseil de l’UE —, Bruxelles reconnaît que le registre numérique de l’EUDR risque l’embolie. Conséquence directe : l’application de la loi anti-déforestation est repoussée d’un an. Après avoir promis de tracer le cacao, le soja ou le bois jusqu’à la parcelle GPS près, l’Europe trébuche donc… sur son propre serveur.
Un règlement taillé pour les données
Rappelons l’ambition du texte adopté en 2023 : bannir du marché européen tout produit lié à une déforestation postérieure à 2020. Comment ? Par une diligence raisonnée, qui oblige chaque importateur à géolocaliser la parcelle d’où provient son produit, à vérifier sa légalité et à soumettre le tout dans un système informatique central. C’est ce système d’information européen qui devait devenir la colonne vertébrale de la loi. Concrètement, il s’agit d’une plateforme centralisée permettant aux opérateurs de déposer leurs déclarations de diligence raisonnée (DDS). Deux modes d’accès sont prévus : une interface web pour les petits volumes et, pour les grands groupes, une API machine-to-machine capable d’ingérer des flux massifs de données au format GeoJSON. Chaque déclaration doit inclure la géolocalisation précise des parcelles (points ou polygones), les données sur le produit, et une attestation de conformité. Le système est conçu pour s’interfacer avec les systèmes douaniers nationaux via le guichet unique européen (EU Single Window Environment for Customs), afin de déclencher automatiquement les contrôles. Les autorités compétentes des États membres y accèdent pour vérifier la cohérence des données, déclencher des inspections ciblées et, in fine, autoriser ou bloquer l’entrée d’un lot sur le marché.
En théorie, le mécanisme est élégant : une base de données unique, alimentée en flux tendu par les opérateurs et contrôlée par les États. En pratique, il suppose d’ingérer des millions de fichiers géospatiaux, de croiser des polygones de parcelles avec des images satellites, d’assurer l’interopérabilité avec vingt-sept systèmes douaniers et de délivrer des temps de réponse acceptables.
L’argument de la panne à venir
C’est ici que Bruxelles a sorti le signal d’alarme : sans garanties de performance, le système risquerait de ralentir à des niveaux inacceptables ou de subir des perturbations répétées. D’où la proposition, formulée fin septembre, de reporter encore d’un an l’entrée en vigueur.
Pour ses promoteurs, c’est de la prudence. Pour ses détracteurs, un prétexte. « Les avocats lèvent les yeux au ciel », résume l’ONG ClientEarth dans un communiqué au vitriol. Le WWF fustige de son côté « the dog ate my homework », y voyant un prétexte technico-informatique et un recul face aux pressions politiques. Le texte avait déjà été repoussé une première fois en 2024 ; le nouvel argument tombe à point nommé alors que les pressions des filières exportatrices s’intensifient.
Derrière la technique, la donnée
Au-delà du serveur et de ses performances se cache un problème plus profond : la qualité et la gouvernance de la donnée qui alimente ce système. Les informations proviennent de sources hétérogènes, traitées selon des logiciels et des méthodes différentes. Résultat : incohérences massives. Une même parcelle peut être jugée conforme par l’outil d’un acheteur et rejetée par celui d’un autre, faute de standards communs et de protocoles d’interopérabilité.
Les contrôles automatisés reposent encore largement sur des déclarations peu vérifiées, ouvrant la porte aux faux positifs comme aux faux négatifs. Des cargaisons parfaitement conformes peuvent être bloquées, tandis que d’autres, à risque, passent entre les mailles. À grande échelle, ce biais fabrique une traçabilité robuste en apparence, mais fragile en réalité. Une illusion de conformité : des rapports impeccables sur le papier, mais incapables de refléter fidèlement la complexité des chaînes d’approvisionnement (voir encadré).
Le report évoqué par la Commission pourrait donc être mis à profit pour autre chose qu’un simple upgrade technique. Il devrait permettre de définir enfin des standards communs de collecte et de validation, de mettre en place des mécanismes indépendants de contrôle qualité et de clarifier la chaîne de responsabilité entre producteurs, intermédiaires numériques, importateurs et autorités publiques. Car l’EUDR ne se joue pas seulement dans les datacenters de Bruxelles, mais dans la capacité de l’Europe et de ses partenaires à construire une gouvernance partagée des données.
La fracture au Parlement
Le débat traverse désormais le Parlement européen. Les Socialistes & Démocrates (S&D) accusent la Commission de « céder aux lobbyistes », tandis que le PPE estime le délai nécessaire pour améliorer un texte qu’il juge défaillant. Les ONG parlent d’un recul dans la lutte contre la déforestation. Certaines entreprises affirment avoir déjà investi dans la traçabilité et redoutent que le report ne transforme leurs efforts en perte sèche, tandis que d’autres, moins avancées, voient au contraire dans ce délai un répit bienvenu.
Une Europe piégée par sa propre ambition numérique ?
En filigrane, l’affaire dit beaucoup de la nouvelle manière de faire des lois : les textes environnementaux européens reposent désormais sur des infrastructures numériques sophistiquées, censées automatiser le contrôle et rendre les obligations infaillibles. Mais cette dépendance à l’IT transforme chaque deadline en stress test technologique. Si l’outil flanche, c’est toute la promesse qui vacille.
L’EUDR ne s’effondre pas : il est toujours là, repoussé à fin 2026. Mais la petite musique de la « simplification » et de la « réalité technique » prend de l’ampleur. Et l’on voit déjà poindre le risque d’un rabotage progressif : moins de données, moins de contraintes, moins d’ambition.
Le sort du règlement reste suspendu. La Commission européenne, par la voix de la commissaire Jessika Roswall, a donc proposé de décaler l’application de l’EUDR à décembre 2026, au motif que le système informatique n’est pas prêt. Mais ce délai n’a rien de définitif : il devra encore être validé par les deux colégislateurs, le Parlement européen et le Conseil de l’UE. En attendant, Bruxelles poursuit ses tests techniques et promet d’améliorer la qualité des données et l’interopérabilité du registre. Reste à voir si, en 2026, l’Union saura transformer sa promesse politique en réalité technologique… et en réalité de terrain.
À LIRE AUSSI :

L’EUDR rappelle une évidence : la technologie ne fait pas tout
À première vue, l’Europe semble avoir trouvé la solution miracle pour lutter contre la déforestation : il suffirait de croiser des images satellites et des bases de données pour savoir si un produit est « propre » ou non. Mais la réalité est plus complexe.
Dans de nombreux pays exportateurs, il n’existe pas de cadastre fiable. Comment prouver qu’une parcelle appartient bien à tel producteur, ou qu’elle est exploitée légalement, quand il n’y a aucun registre officiel ? L’EUDR oblige pourtant les importateurs à fournir ces preuves. Sans documents locaux, il faut alors se tourner vers des alternatives : coordonnées GPS, attestations coutumières, ou certificats délivrés par les autorités.
Même les satellites ont leurs limites. Au seuil retenu de 0,5 ha, ils peinent à distinguer une petite clairière d’une parcelle agricole, avec un risque d’erreurs non négligeables. Résultat : certains lots conformes risquent d’être bloqués à tort, quand d’autres, plus douteux, peuvent passer entre les mailles.
Et derrière ces chiffres, il y a une réalité bien tangible : des familles entières dont le destin dépend de décisions prises à Bruxelles par des technocrates qui n’ont jamais mis un pied sur une parcelle agricole. Pour elles, un faux positif (de 10 à 20% d’erreurs) n’est pas une simple anomalie statistique : c’est un revenu bloqué, une récolte dépréciée, une économie locale fragilisée.
Un pixel ne se nourrit pas, un algorithme ne laboure pas. Ceux qui subissent les faux positifs de l’EUDR ne sont pas des lignes de code, mais des producteurs pour qui un lot bloqué signifie une année perdue, des familles sans ressource. Il est facile de brandir des cartes et des pourcentages depuis Bruxelles. Plus difficile d’assumer qu’un clic erroné peut priver une famille de revenus, fragiliser une filière entière. L’EUDR ne pourra être crédible que si la donnée numérique est confrontée, corrigée et validée par ceux qui connaissent et sont sur le terrain.