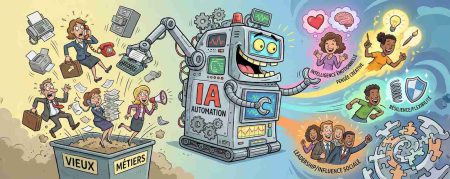Gouvernance
Bruxelles enterre le « fair share » : les telcos européens abandonnés sur le champ de bataille numérique
Par Thierry Derouet, publié le 26 août 2025
Au cœur de l’été, Bruxelles a mis fin à dix ans de bataille des télécoms. Sans bruit, une phrase a suffi : l’Union européenne n’imposera pas de frais d’utilisation du réseau. Le “fair share”, qui devait contraindre les Big Tech à financer une partie des infrastructures, est mort et enterré. Les régulations phares DMA et DSA sont sauves, mais les opérateurs sortent perdants.
L’histoire retiendra que tout s’est joué dans une temporalité quasi imperceptible. Le 31 juillet dernier, Thomas Regnier, porte-parole sur les questions de souveraineté numérique, de défense, d’espace, de recherche et d’innovation au sein de l’UE, l’indiquait : « Le modèle de network usage fees n’est pas une réponse adaptée pour financer les infrastructures européennes ».
Au surlendemain, les médias internationaux — notamment Politico Europe — soulignaient que le DMA et le DSA — deux piliers de la régulation numérique européenne — semblaient dans la coulisse faire l’objet d’intenses controverses dans les négociations.
Trois semaines plus tard, le 21 août dernier, la déclaration conjointe sur l’accord-cadre commercial entre l’Union européenne et les États-Unis en formalisait l’abandon dans son paragraphe 17 : « Les États-Unis et l’Union européenne s’engagent à s’attaquer aux obstacles injustifiés au commerce numérique. À cet égard, l’Union européenne confirme qu’elle n’instaurera ni ne maintiendra de frais d’utilisation du réseau. »
Une disposition passée presque inaperçue, tant elle a été noyée dans un texte dominé par les questions de droits de douane et d’énergie.
Fair share : un projet sacrifié sur l’autel du commerce transatlantique
Le principe, pourtant, paraissait frappé au coin du bon sens : demander à Netflix, YouTube, Meta, Amazon et consorts, responsables de près de 50 % du trafic Internet en France selon l’Arcep, de contribuer au financement des réseaux qu’ils saturent. Thierry Breton, alors commissaire européen au Marché intérieur, avait soutenu l’idée, allant jusqu’à publier un livre blanc en février 2024 pour en faire la pierre angulaire du futur Digital Networks Act.
Télécoms : une équation économique devenue intenable
Pour les opérateurs, c’est une douche froide. Leur équation est connue : investissements colossaux dans la fibre et la 5G d’un côté, abonnements bradés dans un marché à quatre acteurs de l’autre, et aucune contribution directe des plateformes qui captent l’essentiel du trafic. La Fédération française des télécoms, par la voix de son directeur général, Romain Bonenfant, tente de temporiser en attendant le projet législatif complet.
D’ici là, le marché bruisse déjà de scénarios de consolidation. La possible cession de SFR est scrutée de près : revenir à trois grands acteurs en France serait une manière de retrouver un peu d’air. Mais cela ne résout pas le problème structurel : comment financer l’explosion des usages numériques sans nouvelle source de revenus ?
Digital Networks Act : une réforme qui esquive le cœur du problème
Tous les regards se tournent désormais vers le Digital Networks Act. La Commission en a présenté les grands axes : migration accélérée du cuivre vers la fibre, couverture 5G et 6G généralisée, sécurisation des câbles sous-marins, harmonisation du spectre, et introduction d’indicateurs écologiques pour réduire l’empreinte carbone du numérique. Autant de chantiers nécessaires, mais aucun ne règle la question centrale du financement.
À défaut d’imposer un “fair share”, Bruxelles mise sur des coopérations volontaires entre opérateurs et plateformes, sur la sobriété numérique et sur la transparence des interconnexions. En clair, plutôt qu’une contribution obligatoire, l’Europe préfère inciter à la compression des flux vidéo, à l’économie de données et à la publication d’indicateurs verts.
Le calendrier, lui, reste implacable : première version du DNA attendue dès ce mois de novembre, mais entrée en vigueur pas avant 2027. Deux années de plus à patienter, sans garantie que la réforme apporte la moindre réponse financière.
Bruxelles peut brandir ses victoires symboliques avec le DMA et le DSA. Mais à quoi bon défendre des principes si, dans le même mouvement, elle abandonne ses infrastructures ? Une Europe qui protège ses textes, mais pas ses réseaux : c’est donc là le vrai prix du compromis ?
À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :