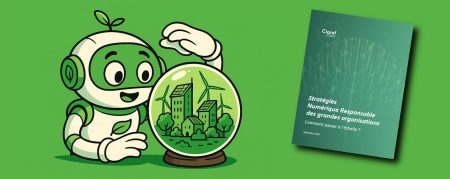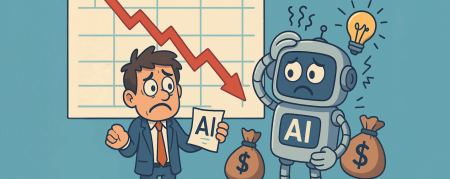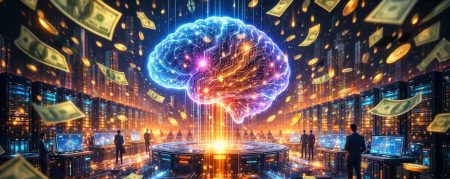Gouvernance
Les 10 Tendances Tech 2026 du Gartner qui doivent influencer la stratégie des DSI
Par Laurent Delattre, publié le 24 octobre 2025
L’innovation n’est plus un sprint mais une architecture. Entre supercomputing, DSLM et IA physique, les DSI deviennent bâtisseurs d’un écosystème intelligent, résilient et responsable. Pour Gartner, la Tech 2026 se dessine entre contrôle et audace. Voici les 10 tendances Tech qui reflètent la façon dont les entreprises doivent réagir à la complexité et aux opportunités de l’ère de l’IA.
La transformation numérique n’est plus un horizon : c’est le quotidien, certes mouvant, parfois heurté, des organisations. Sous la pression combinée de l’IA générative et agentique, de la cybersécurité, des exigences de conformité (AI Act, CSRD), des tensions géopolitiques et d’une économie de ressources (talents, énergie, GPU) plus rare, les DSI doivent réinventer la manière de concevoir, d’opérer et de sécuriser leurs systèmes d’information. Dans ce contexte, l’analyse annuelle de Gartner ne se lit pas comme un catalogue d’innovations, mais comme une boussole stratégique : « Ces tendances ne sont pas de simples innovations, elles sont des impératifs stratégiques. »
« Impératifs », parce que ces tendances Tech conditionnent la capacité des entreprises à passer du prototype d’IA à l’industrialisation, à moderniser des héritages sans rupture de service, à automatiser sans perdre la maîtrise, à partager des données sans en compromettre la souveraineté.
Elles reflètent la réalité des défis des DSI qui doivent simultanément réduire la dette technique, bâtir des plateformes résilientes, gouverner les risques, contenir les coûts et développer des usages utiles dans un monde où l’incertitude réglementaire et géopolitique devient un paramètre d’architecture autant qu’un enjeu de conformité.
C’est précisément l’intérêt du prisme proposé par Gartner pour 2026. Car ses 10 tendances Tech 2026 sont ici regroupées en trois « archétypes » qui structurent l’action. Il y a le DSI « Architecte » qui pose les fondations de demain (plateformes de développement « AI-native », supercalcul d’IA, confidential computing) pour rendre l’IA « construisible » et gouvernable. Il y a le DSI « Synthétiseur » qui organise la valeur (systèmes multi-agents, modèles spécialisés, « physical AI ») pour transformer des promesses en résultats métiers mesurables. Il y a le DSI « Sentinelle »qui protège et crédibilise (cybersécurité préemptive, provenance numérique, plateformes de sécurité de l’IA, géopatriation) afin que la confiance et la souveraineté ne soient pas des vœux pieux mais des propriétés natives des systèmes. Des archétypes qui rappellent qu’en réalité un DSI doit bien porter trois casquettes. Et, au final, maîtriser 10 tendances qui ne dictent pas une mode technologique à suivre « pour être branché » mais tracent une feuille de route pour construire, orchestrer et sécuriser l’entreprise à l’ère de l’IA.
Voici ces 10 tendances…
1- Les plateformes de développement « natives IA » (ANDP)
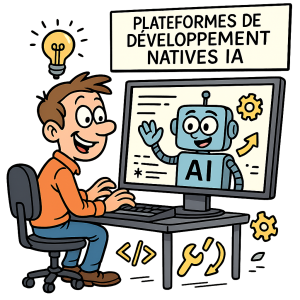
Il s’agit des environnements de développement où l’IA n’est plus un plug-in mais un moteur de productivité et de qualité combinant à la fois codage assisté, génération de tests, refactoring, revue de code, contrôle des bonnes pratiques, détection IA des vulnérabilités, automatisation des documentations, etc. Dit autrement, ces plateformes intègrent l’IA dans toutes les étapes du cycle de vie logiciel, de la conception à la mise en production, pour automatiser, optimiser et accélérer le travail des développeurs.
De ce que l’on comprend, pour Gartner, ces plateformes doivent parallèlement simplifier les cycles de développement de l’IA en personnalisant les modèles, fluidifiant le pipeline AI/ML et en orchestrant les agents IA.
Objectif : raccourcir les cycles, rendre de petites équipes « très productives » et infuser l’IA tout au long du SDLC.
Ce qui n’est pas bien évidemment sans soulever de nouveaux défis de gouvernance (traçabilité du code généré, secrets, licences), d’intégration outillage/CI, de maîtrise des coûts d’inférence, de gestion du risque de dépendance aux modèles.
On retrouve ici des acteurs comme Microsoft (Azure AI Foundry, Visual Studio, GitHub Copilot, Copilot Studio…), Google (Vertex AI, Jules, AI Studio, Gemini Enterprise…), AWS (Sagemaker, Bedrock, Kiro…), IBM (watsonx, DevOps AI) mais aussi Databricks, Snowflake, JetBrains AI, Cursor, Cognition Labs (Devin), Anyscale, etc.
2- Les plateformes de Supercomputing pour l’IA
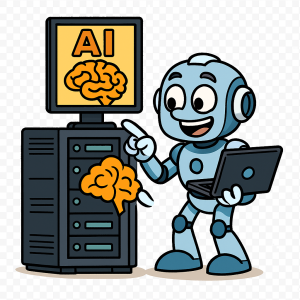
L’IA est gourmande. Très gourmande. Pour s’approprier son potentiel tout en gardant le contrôle sur la conformité et la sécurité, les entreprises sont amenées à se construire des infrastructures de calcul à très haute performance, souvent basées sur des milliers de processeurs graphiques (GPU) ou d’unités de traitement tensorielles (TPU), optimisées pour entraîner les modèles d’IA les plus massifs (modèles de fondation, LLM). Ce qui parallèlement soulève d’importants défis de consommation énergétique, de refroidissement, de disponibilité des puces IA et d’investissements CAPEX/OPEX.
Tous les constructeurs proposent désormais des infrastructures clés en main pour l’IA : Dell AI Factory, HPE Private Cloud AI, Lenovo Hybrid AI, Nutanix GPT-in-a-Box 2.0, etc.
Du côté des GAFAM, les investissements frôlent les 100 milliards de dollars par an (pour chacun) et on peut y ajouter le pharaonique projet Stargate d’OpenAI (avec Oracle et Softbank) ou encore le fameux Colossus de xAI. Sans oublier les investissements européens pour 16 « AI Factories ».
3- Le Confidential Computing

L’idée commence à se généraliser même hors du cloud. Le Confidential Computing (informatique confidentielle) consiste à protéger les données en cours de traitement via des environnements d’exécution de confiance, des enclaves matérielles sécurisées (TEE) où les données et le code sont chiffrés et isolés, même de l’administrateur du système ou du fournisseur de cloud. Grâce à des fonctionnalités ancrées au cœur des processeurs et dans le hardware, ces enclaves permettent à plusieurs organisations (ex: des hôpitaux) de collaborer sur des données sensibles sans jamais les exposer en clair, de créer des Data Clean Rooms, ou encore de protéger des algorithmes financiers critiques dans le cloud.
Le confidential computing s’appuie sur les technologies AMD SEV-SNP et Intel TDX mais commence aussi à apparaître dans l’univers ARM. Des solutions pour l’instant essentiellement proposées par les grands hyperscalers comme Azure (avec ses Confidential VMs, Confidential Containers, Confidential Virtual Desktop, Confidential Ledger, SQL Always Encrypted with Secure Enclave), Google (Confidential VMs, Confidential GKE Nodes, Confidential Dataflow/Dataproc/Space) ou AWS (Nitro Enclaves).
4- Les Systèmes multi-agents

L’avenir n’est pas à l’agent IA mais aux agents IA avec des systèmes où plusieurs agents (spécialisés, parfois outillés) coopèrent pour planifier, exécuter et se contrôler mutuellement. Les systèmes multi-agents contribuent à concrétiser l’idée d’une IA qui travaille en équipe. Les usages sont nombreux. Ils vont de l’automatisation IT/Ops aux essaims de robots dans les entrepôts en passant par la gestion décentralisée de réseaux électriques par exemple.
Ce domaine est encore émergent. On en trouve des bribes dans Gemini Enterprise (avec AgentSpace) ou Azure AI Foundry Agent (et ses agents connectés). La plupart des briques actuelles sont en open-source avec AutoGen Framework (Microsoft), LangGraph+LangChain, CrewAI.
5- Les Modèles de langage spécifiques à un domaine (DSLM)
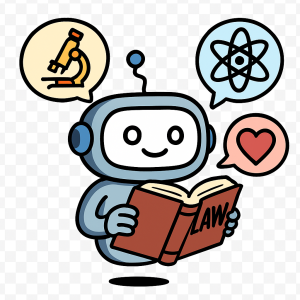
L’arrivée en 2025 de petits modèles très agiles mais surtout faciles à personnaliser et « fine-tuner » a donné naissance à une nouvelle vague de modèles entraînés (ou réentraînés) sur des corpus de données très spécifiques à un métier ou un domaine d’activité. Cela permet de disposer de modèles IA compacts, plus précis, plus en conformité et moins onéreux à opérer. Juridique, médical, ingénierie, chimie… les DSLM émergent dans un peu tous les domaines.
Parmi les cas les plus connus, on peut citer BloombergGPT pour la finance, MedLM de Google et GatorTron de Nvidia dans le médical, AlphaFold de Google et BioGPT de Microsoft dans la chimie, Cybertron de Trend Micro dans la cybersécurité, etc.
6- L’IA Physique (Physical AI)
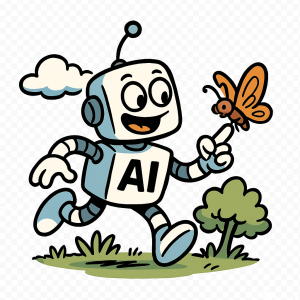
Pour certains, il n’y aura pas d’intelligence artificielle générale sans IA ayant une perception complète du monde réel, du monde physique. Par ailleurs, robots, drones d’inspection, véhicules autonomes, cobots ont également besoin de modèles d’IA Physique pour se doter de capacités de perception, de raisonnement et de manipulation.
Ces modèles soulèvent défis et inquiétudes quant à leur sécurité et leur fiabilité, qui deviennent évidemment critiques dans le monde physique et posent le problème de la sécurité humaine face à l’IA.
Nombreux sont les acteurs qui explorent cette tendance tels que Meta (avec ses World Models), Nvidia (projet GR00T/GR00T N1, Jetson Thor, Isaac), des roboticiens (Agility, Figure, Boston Dynamics…), les spécialistes de l’automatisation industrielle (Siemens, ABB), et les hyperscalers pour la simulation/synthèse.
7- La Cybersécurité préemptive (Preemptive cybersecurity)

Au-delà des approches « Détecter et répondre » d’aujourd’hui, la cybersécurité doit désormais apprendre à « prédire et prévenir ». Dit autrement, les solutions Cyber doivent se doter de capacités préventives et dissuasives dopées à l’IA pour anticiper les attaques, reconnaître et interdire les accès indésirables, perturber les attaques, tromper les attaquants, histoire de stopper la menace avant qu’elle ne se matérialise. Chasse aux menaces (threat hunting) automatisée, identification proactive de vulnérabilités, adaptation dynamique des défenses par l’IA sont autant de pistes poursuivies pour concrétiser cette cybersécurité préemptive. Le principal défi étant de limiter les faux positifs et ne pas noyer les experts sous les alertes.
On y retrouve des acteurs de la « Deception » (leurre) comme MokN, Illusive, TrapX, SentinelOne (qui a racheté Attivo), Smokescreen mais aussi des acteurs AMTD/ASM (Autonomous Mitigation & Threat Detection) / ASM (Attack Surface Management) comme Wiz, Orca, Palo Alto Cortex, IBM Randori, Cycognito ainsi que les traditionnels acteurs de la cybersécurité dopée à l’IA (Crowdstrike, Microsoft, Trend Micro, etc.).
8- La provenance numérique
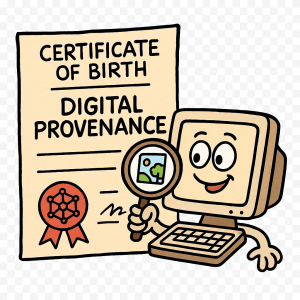
Derrière cette tendance au titre ambigu se cachent en réalité toutes les nouvelles technologies qui permettent de garantir l’origine d’un article (sa provenance) ainsi que l’origine de ses composantes et l’historique des modifications apportées. Ces technologies reposent sur la Blockchain et le watermarking cryptographique. Elles permettent de créer des « certificats de naissance » numériques, des historiques immuables pour les actifs numériques, mais aussi d’alimenter le fameux « Digital Product Passport » (DPP) européen qui doit entrer en vigueur en 2027.
Ces technologies sont devenues indispensables pour lutter contre les deepfakes (en certifiant l’origine d’une vidéo ou d’une image) ou encore garantir la traçabilité des biens de luxe ou des médicaments dans la chaîne d’approvisionnement ou encore certifier l’authenticité d’œuvres d’art numériques.
Différents acteurs évoluent dans ce domaine à l’image de startups françaises spécialistes de la Blockchain comme Keyban, Arianee, Tilkai, mais aussi des ESN comme Docaposte, Eviden, Orange Business, OVHcloud. On rappellera aussi l’initiative internationale C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) soutenue par Adobe, Microsoft, BBC, Truepic, visant à standardiser la provenance des contenus numériques. Plusieurs acteurs européens y participent.
9- Les Plateformes de sécurité de l’IA (AI security platforms)
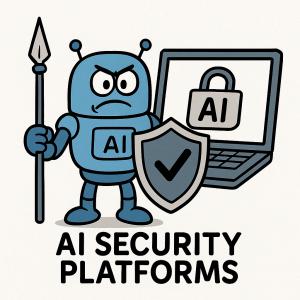
L’IA fait peur. Et l’AI Act impose qu’on la contrôle et qu’on la sécurise. D’où l’émergence de plateformes dédiées à la protection des modèles d’IA eux-mêmes. Elles sécurisent la chaîne d’approvisionnement des données, surveillent les modèles en production contre les attaques (empoisonnement, évasion) et assurent leur intégrité. Elles permettent d’inventorier tous les usages d’IA, d’évaluer les risques (données, modèles, prompts, supply chain), d’imposer des politiques (guardrails, filtrage, RAG sécurisé) et de surveiller en production (journaux, red teaming continu, …).
On commence à voir des référentiels et frameworks comme NIST AI RMF, OWASP Top 10 LLM, et autres s’attaquer au sujet.
Les géants de l’IA ont aussi développé des garde-fous natifs, comme AWS Bedrock Guardrails, Vertex AI Safety chez Google Cloud, ou encore Azure Content Safety chez Microsoft (et son AI Foundry).
Une vague de startups spécialisées s’est engouffrée sur ce marché prometteur avec en France des acteurs comme Giskard, Mithril Security, Numalis, en Europe des acteurs comme NannyML, LatticeFlow ou Lakera et aux USA des jeunes pousses comme Protect AI, CalypsoAI, Deepchecks, Prompt Security, etc.
10- La Géopatriation
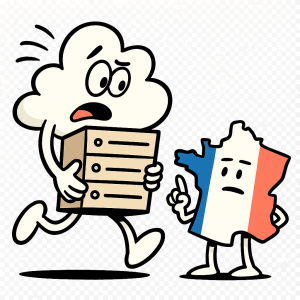
Derrière ce mot barbare se cache un mouvement stratégique des entreprises pour rapatrier leurs données et leurs infrastructures numériques dans leur pays ou région d’origine. Un mouvement que Gartner estime désormais fondamental. Tout simplement parce que c’est une (vraie) réponse à la fragmentation réglementaire mondiale (RGPD en Europe, lois sur les données en Chine…). Une tendance également née des débats autour de la souveraineté numérique européenne et la nécessité de relocaliser des applications/données des clouds publics « globaux » vers des options locales ou souveraines (régionaux, cloud de confiance, data centers propres) pour réduire les expositions géopolitiques, réglementaires ou contractuelles.
Une tendance qui soulève bien évidemment de nombreux défis : Le coût et la complexité de la migration, la fragmentation des stacks, la perte de flexibilité offerte par le cloud mondial et le risque de « balkanisation » d’Internet.
Mais en France, des acteurs comme OVHcloud, 3DS Outscale, Scaleway, Cloud Temple, NumSpot et d’autres (y compris Bleu et S3NS) comptent sur cette tendance pour amplifier leur business dans les années à venir.
Ce que toutes ces tendances démontrent, c’est que la transformation numérique entre dans une nouvelle phase. À l’aube de 2026, les DSI se trouvent à la croisée des chemins : plus que jamais, leur rôle dépasse la simple gestion technologique pour devenir un véritable levier de transformation et de résilience pour l’entreprise. Ils devront se montrer par moment « architecte » en prenant des décisions d’urbanisation (où placer l’effort, comment accéder à la puissance, et comment sécuriser l’IA), par moment « synthétiseur » en concevant des systèmes (et pas des démos) d’agents coopérants, de modèles spécialisés, d’IA qui agit dans le réel. Enfin, ils auront aussi à jouer le rôle de « sentinelle » en imposant une défense préemptive, la preuve de provenance et des plates-formes de sécurité de l’IA transverses, avec en toile de fond des arbitrages géopolitiques.
L’année qui s’annonce sera donc pour beaucoup de DSI celle de l’audace, de l’expérimentation et de la capacité à fédérer autour de nouveaux modèles de collaboration, tant en interne qu’avec l’écosystème. Face à l’accélération des cycles d’innovation et à la montée des incertitudes, la clé sera d’adopter une posture proactive, d’investir dans le développement des compétences et de cultiver une culture d’apprentissage continu.
À en croire Gartner, 2026 va inviter les DSI à repenser leur leadership, à renforcer leur agilité organisationnelle et à s’affirmer comme architectes de la confiance numérique, garants de la valeur et de la durabilité des choix technologiques. Plus que jamais, la réussite passera par la capacité à anticiper, à s’adapter et à inspirer. Fascinant non ?
À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :

À LIRE AUSSI :