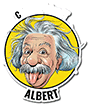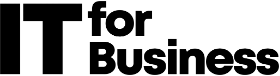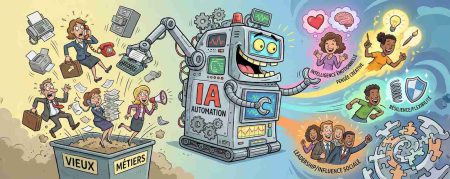Gouvernance
Thierry Breton (PDG d’Atos) : « Les données numériques seront notre pétrole de demain »
Par Adrien Geneste, publié le 20 janvier 2014
Ex-ministre et grand patron européen convaincu, Thierry Breton perçoit le développement des industries numériques – cloud, big data, objets connectés – comme une chance pour les entrepreneurs français.
L’ancien ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie de Jacques Chirac dirige, depuis 2008, Atos, une des premières sociétés de services informatiques mondiales, avec 8,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 77 000 salariés en 2013. A bientôt 59 ans, Thierry Breton ne fait pas mentir sa réputation de grand capitaine d’industrie à la tête de la plus ancienne SSII française. Après avoir dirigé et redressé Thomson, de 1997 à 2002, puis France Télécom, de 2002 à 2005, l’ingénieur a fait progresser de 55 % en cinq ans les revenus d’Atos, et multiplié par cinq la valeur boursière de l’entreprise. Aujourd’hui chargé de deux missions sur le développement du cloud, il plaide pour une harmonisation européenne des réglementations, condition nécessaire à l’essor de cette industrie qu’il considère comme une véritable révolution pour les entreprises.
Atos vient de présenter son plan triennal. Quelles sont vos ambitions ?
Thierry Breton : Nous voulons améliorer d’un à deux points la marge opérationnelle de la société d’ici à la fin 2016, avec une croissance moyenne de 2 à 3 % du chiffre d’affaires. Les perspectives concernant nos deux grands métiers sont bonnes. D’une part, nous sommes le premier opérateur industriel de services numériques, en particulier d’infogérance et de cloud. D’autre part, notre filiale Worldline, avec plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires, est l’un des premiers acteurs européens dans les activités de paiement. Nous souhaitons d’ailleurs lui donner les moyens de se développer par le biais d’une introduction en Bourse, probablement en 2014.
Comment faire pour libérer le DSI de son image de cost killer ?
TB : En faisant évoluer sa fonction. A côté de la charge de gestion opérationnelle des systèmes traditionnels, plutôt du côté back office, il doit piloter les nouveaux projets à fort impact métier, créateurs de nouveaux services. Tout en prenant en compte toutes les dimensions de la révolution digitale et en accompagnant la transition que celle-ci implique pour l’ensemble des métiers de l’entreprise. Avec le cloud, le BYOD (Bring Your Own Device), la mobilité, le big data et les réseaux sociaux, la technologie s’impose à tous. Atos aide les DSI à relever ces défis.
Vous êtes un des coordinateurs du groupe de réflexion sur le cloud, l’un des 34 projets d’avenir d’Arnaud Montebourg. Quels sont vos objectifs ?
TB : Je pilote cette initiative avec Octave Klaba, le fondateur d’OVH. Après avoir consulté les acteurs engagés sur ces sujets au niveau national, nous allons cadrer les enjeux et formuler rapidement nos premières recommandations. Nous considérons que le développement du cloud est essentiel pour les entreprises européennes. C’est un élément de compétitivité majeur avec, à la clé, des investissements très importants sur nos territoires, de l’emploi hautement qualifié et, surtout, la création d’infrastructures numériques indispensables au développement des filières digitales de demain. Mais nous avons besoin pour cela d’un cadre de confiance, notamment réglementaire, adapté aux enjeux du développement de cette économie numérique, tout particulièrement en ce qui concerne la protection et la gestion des données.
Que demandez-vous pour réussir ce projet ?
TB : Il est nécessaire que les acteurs qui opèrent en Europe, quelles que soient leurs origines, appliquent des règles exigeantes de qualité de service (SLA ou Service Level Agreement) et de sécurité communes. Mais leurs clients, de leur côté, doivent disposer de garanties contractuelles sur les conditions d’accès, de stockage et de traitement de leurs données. De ce point de vue, il faut aussi garantir aux citoyens et aux entreprises, par des mécanismes adaptés, de contrôle notamment, l’application et le respect de la régulation européenne des données numériques. Pour cela, on peut imaginer un espace de confiance de partage de données (Shared Data Area) qui dépasse les cadres nationaux. Car le cloud est transfrontière par nature. Nous avons la chance d’avoir un espace européen relativement homogène. Il nous faut donc utiliser cette opportunité pour offrir ces services à cette échelle et développer une industrie à la taille du continent européen, c’est-à-dire plus de 500 millions d’habitants : une fois et demie les Etats-Unis !
C’est ce que vous entendez quand vous prônez un « Schengen des données » ?
TB : Cette expression est née de nos discussions entre membres de l’ECP (European Cloud Partnership) dans le cadre de la mission que nous menons pour le développement du cloud en Europe avec Jim Snabe, le coprésident de SAP, pour le compte de la Commission européenne. Quand nous parlons de « Schengen des données », nous disons qu’il nous semble souhaitable que des pays pionniers adhèrent rapidement à un ensemble de règles communes afin de créer la confiance nécessaire à l’investissement et au développement des usages dans le cloud. Il ne s’agit en aucun cas de s’abriter derrière une ligne Maginot artificielle. Simplement, nous pensons que la démarche progressive de l’ « opt-in » (consentement préalable) est adaptée, comme cela avait été le cas dans la mise en place des accords de Schengen. Ainsi nous pourrions avoir un cloud en France qui puisse servir les différentes administrations françaises, mais aussi celles d’autres Etats, et réciproquement, bien évidemment. On peut comprendre, bien sûr, que les usagers ne souhaitent pas que certaines données, comme celles liées à leurs dossiers fiscaux ou médicaux, soient traitées ailleurs que dans leur propre pays. Là-dessus, il convient de respecter, voire de renforcer les cadres nationaux. Mais sur un très grand nombre d’informations, moins sensibles, et dans la mesure où ces territoires adoptent exactement les mêmes types de normes de protection, de garanties et assurent la confiance nécessaire – notamment par des mécanismes effectifs et communs de contrôle –, pourquoi ne pas s’engager dans cette voie génératrice d’économies, de progrès et de compétitivité ? L’Europe ne peut pas se permettre de rater la nouvelle révolution industrielle digitale.
Les révélations d’Edward Snowden cet été ont-elles refroidi les ardeurs des Européens
en la matière ?
TB : Le moins que l’on puisse dire, c’est que le climat créé n’a pas contribué à favoriser l’espace de confiance que nous voulons susciter ! Notre démarche, bien antérieure à cette affaire, n’est donc en rien une réaction des Européens aux révélations de l’été, et à l’émotion provoquée dans de nombreux pays. Historiquement, nous avons d’abord dû organiser les espaces territorial, puis maritime et aérien dans lesquels se sont progressivement développées les activités des nations. Aujourd’hui, il convient d’organiser dans le même esprit notre secteur informationnel numérique. Dans tous ces domaines, il y a toujours eu des questions de souveraineté, de défense, d’intelligence… Mais tout ceci dépasse le champ de notre mission, bien entendu.
La collecte de données à grande échelle n’est donc pas un danger, selon vous ?
TB : Je ne le crois pas. Les données sont « l’or numérique », le pétrole de demain. D’ailleurs, pour certaines entreprises, pas encore assez européennes du reste, elles le sont déjà. Leur exploitation ouvre des champs infinis à l’innovation. Nous estimons que tous les deux ans, nous générons autant d’informations que toute l’humanité en a créées depuis qu’elle existe. Aujourd’hui, nous laissons tous une trace numérique stockée ad vitam aeternam. Des données de toute nature, qui peuvent être agrégées et mises en cohérence dans des buts précis de suivi, d’identification, de meilleure connaissance des acteurs qui en sont à l’origine, et qui acceptent de les partager pour bénéficier, en retour, du résultat de leur traitement. Certaines solutions sont déjà capables, par exemple, d’analyser le parcours alimentaire et de santé d’une personne, d’identifier les pathologies et les risques éventuels très en amont. Ce n’est qu’un exemple parmi mille autres de la façon dont les données peuvent contribuer à notre mieux-être. A chacun, évidemment, de décider quelle trace informationnelle il souhaite laisser, à qui et pour combien de temps.
Une des applications de cette collecte concerne même les objets, qui peuvent être connectés…
TB : Tout à fait. Il s’agit de la deuxième vague de cette formidable révolution. On va pouvoir anticiper l’obsolescence d’une pièce mécanique en fonction de son usage réel et ainsi la remplacer avant la panne ; payer notre assurance auto selon notre manière de conduire ; personnaliser la posologie d’un médicament en fonction des paramètres personnels du patient mesurés en temps réel, ou encore anticiper la formation des bouchons routiers par l’intermédiaire des voitures connectées. Nous rentrons dans un monde où nous serons tous reliés aux autres, mais aussi à toutes choses. La gestion de ces flux d’informations, l’analyse de leur cohérence, ainsi que leur mise en perspective devraient générer une créativité – et donc une activité – considérable. Ce qui signifie une transformation économique de très grande ampleur.
La France devrait-elle miser davantage sur ces technologies ?
TB : Notre pays est sans doute mieux placé que d’autres. Car il peut compter sur ses grandes écoles, ses universités et sur une longue histoire avec les technologies de l’information et les services, le tout favorisant de nombreuses innovations. N’oublions pas que le mot « informatique » est né dans l’Hexagone. Cela dit, les nouvelles générations sont beaucoup plus européennes que la mienne à leur âge. Le succès extraordinaire du programme pour étudiants Erasmus, ces vingt dernières années, y est pour beaucoup. Et les créateurs d’entreprises d’aujourd’hui considèrent l’Europe comme leur marché naturel. Quant au numérique, les jeunes y viennent d’eux-mêmes, et de plus en plus nombreux.
Vous avez donc confiance en l’avenir ?
TB : Absolument. Laissons les jeunes utiliser les données numériques disponibles sur le continent européen et ils inventeront des millions d’applications et d’usages dont nous n’avons pas la moindre idée aujourd’hui. Leur créativité est inimaginable. Prenez la solution Evergreen, lauréate cette année de l’IT challenge d’Atos, sorte d’Olympiades du numérique que nous organisons tous les ans dans les universités européennes. Des étudiants autrichiens ont utilisé les informations disponibles des feux de signalisation de grandes villes européennes pour concevoir une appli de géolocalisation capable de dire dans combien de temps le feu passera au vert, et de proposer un itinéraire et une vitesse à respecter pour éviter les feux rouges. Renault étudie déjà comment l’intégrer dans ses nouvelles voitures. Les données sont là. Le tout est de pouvoir les utiliser. Ensuite, l’imagination est sans limite. A nous de les rendre disponibles dans un espace de confiance, le Shared Data Area, sur lequel Jim Snabe et moi travaillons.
Propos recueillis par Sebastien Dumoulin et Frederic Simottel