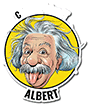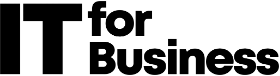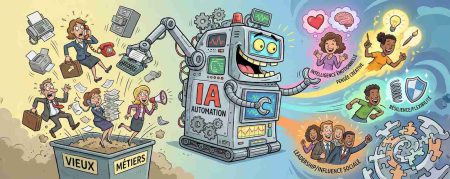Gouvernance
Thierry Breton persona non grata : la bataille américaine du « free speech » arrive dans vos contrats IT
Par Thierry Derouet, publié le 30 décembre 2025
Fin décembre, Washington a interdit l’entrée à Thierry Breton — ancien commissaire européen — et à quatre acteurs européens de la lutte contre la haine et la désinformation. Officiellement pour contrer une prétendue censure de points de vue américains ; en pratique, un signal clair : la mise en œuvre du DSA/DMA s’invite désormais dans la géopolitique, avec des retombées concrètes sur les relations entre DSI européens et plateformes américaines.
Dans la version américaine, l’affaire tient dans une formule de Marco Rubio : cinq personnes auraient mené des « efforts organisés » pour « contraindre des plateformes américaines à censurer, démonétiser et supprimer » des points de vue américains. Le communiqué ajoute l’étiquette de l’époque, celle qui transforme un débat technique en récit de guerre culturelle : « militants radicaux » et « ONG instrumentalisées ».
La presse américaine la plus « factuelle » ne s’y trompe pas : l’Associated Press relève que la décision s’inscrit dans une politique annoncée en mai 2025, conçue pour refuser l’entrée aux étrangers jugés responsables de « censure » visant des discours protégés aux États-Unis — et qu’ici, l’outil choisi n’est pas un contentieux, mais l’immigration, autrement dit un levier unilatéral, rapide, extensible.
Pour un DSI européen, la clef géopolitique est simple : Washington ne se contente pas de discuter d’un texte de marché. Il transforme un désaccord sur la régulation en un geste de souveraineté. Autrement dit, ce n’est plus seulement « nous contestons une procédure », mais « nous imposons une conséquence personnelle pour ceux qui appliquent la règle ». Et Marco Rubio le dit sans détour : d’après lui, ces campagnes de censure peuvent provoquer des conséquences sérieuses sur la politique étrangère américaine.
Ce que cela signifie pour un DSI, c’est moins un changement juridique immédiat qu’un changement de climat : l’application d’une règle européenne devient susceptible d’être perçue, aux États‑Unis, comme un acte ayant un coût politique personnel, et donc comme un levier de pression.
Pourquoi Thierry Breton, alors qu’il n’est plus commissaire ?
Justement parce qu’il ne l’est plus. Dans une stratégie de pression, un ex‑commissaire a un avantage : il offre une cible symbolique sans déclencher aussitôt l’affrontement frontal avec les titulaires en poste. AP rappelle que Breton est présenté comme une figure clé de l’arsenal européen, fortement associée au DSA. Reuters et d’autres reprises, dont Al Jazeera, soulignent que l’administration a même qualifié Breton de « cerveau » du DSA — une façon de dessiner un adversaire identifiable, simple à nommer dans le récit.

Thierry Breton réplique au visa ban américain en évoquant un vent de maccarthysme, rappelant que le DSA a été adopté par une large majorité du Parlement européen.
Breton, lui, choisit de riposter dans le registre américain : il parle de « chasse aux sorcières » et renvoie au maccarthysme. Ce n’est pas seulement une pique, mais une bataille de références — une manière de dire aux États‑Unis qu’il connaît leur mythologie politique.
Les quatre autres personnes : pourquoi Washington les met dans le même cadre
La liste n’a rien d’un hasard. Washington a choisi, à côté de Breton, des profils qui incarnent ce que l’on pourrait appeler l’« outillage » de la régulation :
Imran Ahmed (Center for Countering Digital Hate), Clare Melford (Global Disinformation Index), Josephine Ballon et Anna-Lena von Hodenberg (HateAid).
Là encore, la manière américaine de raconter est révélatrice : Rubio parle d’ONG « instrumentalisées », et Reuters résume la logique comme une accusation de « censure » et de régulation « trop lourde » visant des entreprises américaines.
Côté européen, les organisations ciblées retournent la charge. Plusieurs dépêches reprennent la même lecture : la mesure américaine viserait en réalité à entraver l’application du droit européen par des entreprises opérant en Europe. Reuters rapporte qu’HateAid et sa direction estiment que le visa ban constitue une tentative de bloquer l’application de la loi européenne, et qu’elles ne se laisseront pas intimider. De son côté, le Global Disinformation Index qualifie l’action américaine d’illégitime et d’attaque autoritaire. Le choc de vocabulaire devient alors net : Washington accuse l’Europe de « censure », tandis que ces organisations répondent qu’on cherche à les réduire au silence.
Le point de vue américain : « free speech », suspicion d’influence, et fatigue des élites
Pour un DSI européen, le piège est de lire cette séquence uniquement comme un différend de droit. Aux États-Unis, la liberté d’expression est une matrice identitaire et constitutionnelle ; elle n’est pas un paragraphe, elle est un réflexe. Dans l’Amérique de 2025, ce réflexe est devenu un champ de bataille intérieur : une partie de la vie politique est convaincue qu’un ensemble d’acteurs — administrations, experts, ONG, plateformes, universités — a appris à « discipliner » la parole en faisant pression sur des intermédiaires privés plutôt qu’en légiférant. The Verge résume cette vision avec l’expression reprise par l’administration : « complexe mondial de la censure », et souligne la menace d’extension : « nous sommes prêts à étendre cette liste ».
Ce n’est pas une vue de l’esprit : en mai 2025, Reuters rapportait déjà que Rubio jugeait « inacceptable » que des gouvernements étrangers exigent ou menacent des actions légales à propos de contenus publiés depuis le sol américain, et qu’il dénonçait des demandes de standards de modération « globaux ». Le conflit n’est donc pas seulement « UE vs plateformes », il devient « juridiction européenne vs récit constitutionnel américain ».
Quand la régulation européenne est vécue comme « extraterritoriale »
Le DSA fixe en Europe des obligations de diligence : transparence, gestion des risques, dispositifs de signalement, etc. C’est un cadre pensé pour le marché européen, pas une doctrine mondiale. Pourtant, du côté américain, le raisonnement est le suivant : si une plateforme américaine durcit ses règles partout — y compris hors d’Europe — pour réduire son risque en Europe, alors le règlement européen produit, de fait, un effet mondial. Pour les États‑Unis, cela revient à dire que l’Europe a, indirectement, imposé sa norme à l’échelle globale.
C’est exactement le cadrage qu’on retrouve dans les dépêches américaines. Reuters cite Marco Rubio affirmant que les personnes visées ont mené des efforts organisés pour contraindre des plateformes américaines à censurer, démonétiser et supprimer des points de vue américains. Ce langage fait le lien direct entre une régulation européenne et une atteinte — réelle ou supposée — à la parole américaine.
De son côté, l’Associated Press rappelle que l’administration américaine a fait de cette logique une politique formelle : refuser l’entrée à des étrangers jugés responsables de censure de discours protégés aux États‑Unis, en soulignant le risque de conséquences graves en politique étrangère. Cela illustre bien le passage d’un débat technique à une posture de souveraineté : l’enjeu n’est plus seulement administratif ou juridique, il devient diplomatique.
En ajoutant une dimension de dissuasion, l’administration ne s’adresse pas uniquement à Bruxelles ou à ses institutions. Elle vise aussi tous ceux qui rendent la régulation opérante, c’est‑à‑dire les organisations et personnes qui documentent, signalent ou facilitent l’application de ces règles — les fameux watchdogs, chercheurs, ONG.
Autrement dit, le message américain n’est pas seulement : vous régulez différemment. Il est aussi : vous créez, peut‑être sans le vouloir, un standard qui affecte notre espace de parole. Et si l’on va plus loin, la mise en scène de ce message se fait en frappant des personnes concrètes, pas seulement un texte : un ancien commissaire, des dirigeants d’ONG, un chercheur… Le but est d’atteindre ceux qui rendent la règle vivante, pour les dissuader, et plus largement pour signaler à tous que l’on surveille l’application, pas seulement la lettre de la loi.
La réponse européenne : « nos règles, notre marché »
Le Washington Post rapporte la ligne européenne : l’UE revendique son droit souverain à réguler l’activité sur son marché, et rejette l’idée d’une portée extraterritoriale. Reuters cite Macron parlant d’« intimidation et coercition » et rattachant l’affaire à la « souveraineté numérique » européenne.
Dans ce miroir, chacun parle de « liberté », mais pas au même endroit : Washington la place d’abord dans la circulation des opinions, Bruxelles la place dans l’État de droit numérique et la responsabilité des plateformes vis-à-vis des risques.
Quand la météo géopolitique entre dans vos contrats
L’impact immédiat ne se traduit pas par un nouveau texte de loi, mais par une relation fournisseur qui se raidit. Quand Washington affirme que la conformité au DSA peut entraîner des conséquences graves en politique étrangère, cela change la façon dont une grande plateforme américaine va gérer chaque demande ou chaque incident. On passe d’un échange purement technique à un échange pesé d’enjeux politiques.
Concrètement, cela veut dire que, chez les grands acteurs, on verra plus souvent des arbitrages de type public policy : avant de répondre à une demande, on consulte davantage les équipes qui suivent la politique publique, on vérifie le risque politique, on pèse l’impact médiatique. La judiciarisation des échanges augmente : au lieu d’une simple confirmation ou d’une procédure automatisée, on a une réponse plus encadrée, parfois plus lente, souvent plus écrite, pour se protéger. La communication devient plus politique : les explications sont calibrées, les choix sont justifiés en prenant soin de ne pas alimenter un discours de censure. Et parfois, la plateforme segmente plus strictement les fonctionnalités, l’accès ou les règles selon les zones géographiques, pour limiter le risque dans des contextes très sensibles.
Dans la pratique, cela se traduit par un bruit de fond que l’on ressent au quotidien :
– des délais plus longs quand il faut remonter un sujet délicat vers des équipes seniors ou politiques ;
– des clauses plus prudentes sur l’accès aux données, sur la transparence, ou sur la façon dont on peut exploiter certains signaux ou rapports ;
– des mécanismes d’audit et de preuve plus formels, plus exigeants, pour montrer qu’on agit correctement et qu’on ne pousse pas la plateforme dans un débat politique dangereux ;
– des demandes de support ou d’escalade qui passent par davantage de filtres, parfois des juristes ou des responsables de politique publique, avant d’aboutir à une décision.
On n’a pas besoin d’un nouveau règlement pour subir ce resserrement : il suffit que la conformité devienne un marqueur politique, associé à un récit de souveraineté ou à un risque diplomatique. Quand la menace de sanctions se fait personnelle — comme dans la déclaration américaine indiquant que la liste peut s’élargir, reprise notamment par la presse spécialisée — les plateformes comprennent très vite qu’elles doivent jouer plus serré.
Le second effet, plus discret mais tout aussi important, touche la culture interne et la pédagogie vis‑à‑vis du COMEX. Beaucoup d’organisations européennes considèrent DSA/DMA comme un sujet de conformité, un dossier technique à cocher. Le visa ban raconte autre chose : une part des États‑Unis lit ces textes à travers une sociologie politique très polarisée, où le mot censure sert d’explication globale pour des conflits de pouvoir et d’influence. Si l’on n’intègre pas ce prisme, on risque de ne pas comprendre certaines réactions de partenaires américains, certaines prises de position publiques, et parfois certains changements de cap produits. Comprendre ce prisme ne signifie pas l’approuver ; cela signifie éviter d’être surpris quand un sujet trust & safety ou transparence se retrouve, chez un fournisseur ou dans un débat public, requalifié en affrontement de souverainetés.
Au final, l’Europe voit dans ce geste, fondamentalement, une pression. L’administration américaine le présente comme une défense. Entre les deux, le DSI n’a pas le luxe d’adopter un seul récit. Il doit maintenir services, contrats, flux de données et dépendances logicielles dans un climat où l’on confond de plus en plus volontiers une exigence de conformité avec une déclaration politique.
À LIRE AUSSI :